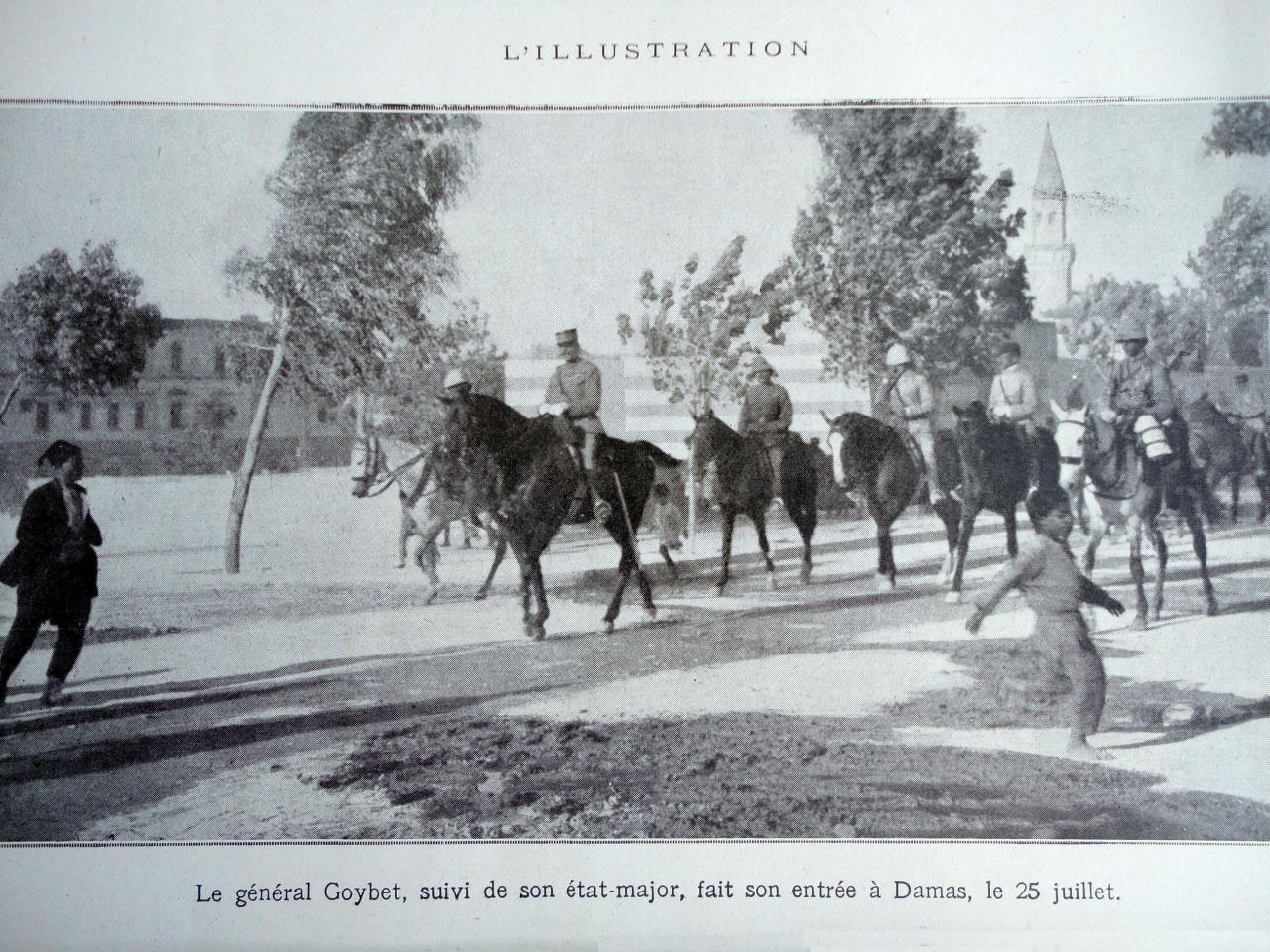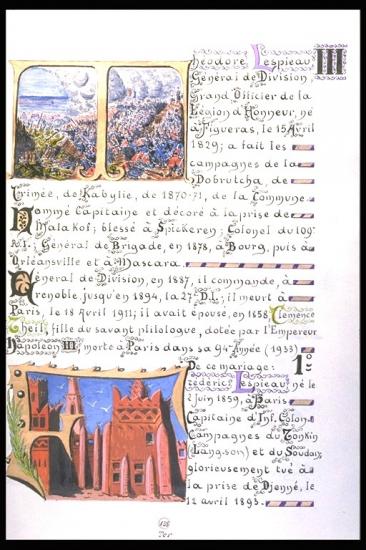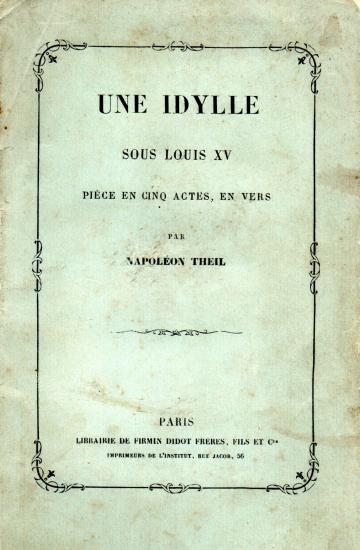Philologue Napoleon Theil (1808-1878), Professeur aux Lycées Henri IV & Saint Louis, Paris, Traducteur , auteur de pièces
Mariano Goybet (1861-1943) mon arrière grand père, général de division, grand officier de la Légion d'honneur57, épouse le 1er juillet 1887 Marguerite Lespieau (1868-1963), sœur de Robert Lespieau (1864-1947), physicien-chimiste, académicien des sciences58, fille du général Théodore Lespieau et de Clémence Theil, fille de Léon Theil, philologue, garde national lors de la Révolution française de 1848, filleul de l'empereur
Remerçiements à Monseigneur Calixte de Nigremont , (site web http://www.nigremont.com/) qui m'a aimablement transmis après recherche, suite à adjudication de livres anciens, des documents de famille sur Napoleon Theil (notamment cette publication de 1870) : '' Une Idylle sous louis XV . Piece de Napoleon Theil'') ainsi que d'autres documents sur la famille Goybet. J'ai voulu, après l'émotion de consulter des documents sur Napoléon Theil ( le grand père de mon arrière Grand mère Lespieau épouse de Mariano Goybet), lui restituer sa place au sein de la famille.
Henri Goybet
Arbre genealogique depuis Jean François Theil( 1765-1824)
Alliance Lespieau Theil tirée du livre de famille Goybet
Jean François Napoléon Theil, professeur, philologue Français né à langon (Gironde), en 1808 , mort à Provins en 1878. Il fut professeur, à Paris, aux Lycés Henri IV et St Louis , Il est surtout connu par sa traduction de l'Allemand du Dictionnaire de la langue latine composée par Freund (1855-1856) ; par le dictionnaire latin Français (1852) qu'il en a tiré ; par son dictionnaire de biographies, mythologie géographie, anciennes (1869) ; etc,,,,,
Larousse du XXème siècle (1933)*
*Napoleon Theil a également été commandant de la garde nationale en 1848 et participe Révolution française de Fevrier 1848 , notamment aux coté de Alphonse de Lamartine lors de la proclamation par celui-çi de la Deuxième République . Il sera également officier de l'instruction publique et chevalier de la Légion d'Honneur.
Napoléon Ier traversait Langon, se rendant sans doute en Espagne – Entendant des cris d'une nature particulière, il en demanda le pourquoi ? - Sire une des dames de la ville dans un état interessant , émue de vous avoir vu, met son enfant au monde- Eh bien ! Dit l'Empereur , montez lui dire que je serai le parrain ! (tiré des mémoires de Madame Mariano Goybet).
«'Oui, le peuple a des droits que nul ne peut nier !
L’en déclarer déchu, c’est le calomnier !
Si parfois il commet des excès, c’est qu’il souffre !
C’est à nous, ses tuteurs, de le tirer du gouffre. » [10]''
Source : Napoléon Theil, L’Empire, Paris, Plon, 1852.
Worldcat.org/identities Napoleon Theil (1808-1878)
Une idylle sous Louis XV, pièce en 5 actes, en vers, par Napoléon Theil Theil, Napoléon (1808-1878). Auteur du texte. Une idylle sous Louis XV, pièce en 5 actes, en vers, par Napoléon Theil. 1870.
Une Idylle sous louis XV . Piece de Napoleon Theil
Dictionnaire complet d'Homère et des Homérides par Napoléon Theil Hachette 1841
Légion d'Honneur Napoleon Theil en 1858

Napoléon Theil (1808-1878) : Oeuvres
.BNF : Oeuvres de Napoleon_Theil
Auteur de texte (32)
La Guerre d'Orient. Poème (1957)
Grand dictionnaire de la langue latine... par le Dr. Guill. Freund, traduit en français... et considérablement augmenté... par M. Theil,... (1929)
Dictionnaire latin-français (1926)
Grand dictionnaire de la langue latine... par le Dr. Guill. Freund, traduit en français... et considérablement augmenté... par M. Theil,... (1883)
16 janvier 1875. Inauguration du théâtre offert à la ville de Provins par M. Victor Garnier, prologue en vers dits au lever du rideau... [Signé : N. Theil.] (1875)
Une idylle sous Louis XV, pièce en 5 actes, en vers, par Napoléon Theil (1870)
Vers prononcés au banquet des fonctionnaires du Lycée impérial Saint-Louis, le 14 février 1863, par M. N. Theil... (1863)
La Guerre d'Orient, poème... par M. Napoléon Theil,... (1857)
À un ami exilé... [Signé : Napoléon Theil.] (1856)
Grand dictionnaire de la langue latine... par le Dr. Guill. Freund, traduit en français... et considérablement augmenté... par M. Theil,... (1855)
Lycée impérial Saint-Louis. Discours prononcé à la distribution solennelle des prix, le 14 août 1855, par M. Theil,... (1855)
Recueil de morceaux choisis dans les auteurs classiques de la littérature française, et destinés à la récitation, par M. Theil,... (extrait du grand Recueil grec, latin et français...) 2e édition (1853)
Lettres philologiques, réponse aux observations critiques faites par M. Helleu,... et par M. Rinn,... sur le "Nouveau dictionnaire latin-français" publié d'après Freund, par M. Theil. [Signé : N. Theil.] (1853)
Dictionnaire latin-français, rédigé... principalement d'après le grand ouvrage de Freund, par M. Theil,... (1852)
L'Empire, par M. Napoléon Theil (1852)
Seize mois de commandement dans la garde nationale parisienne, mémoire justificatif adressé par M. Theil,... à ses collègues universitaires, à ses camarades de la garde nationale... (1849)
Candidature... Aux électeurs du département de la Seine (1848)
Vers prononcés au banquet du 14 novembre aux Tuileries, par le citoyen Theil,... [ - Vers prononcés à l'occasion de la bénédiction du drapeau offert par la XIe légion à la garde nationale de Calais, par le commandant Theil,...] (1848)
Au Pays et aux Chambres. La Vérité sur la question de l'Enseignement (1847)
Au pays et aux Chambres : la vérité sur la question de l'enseignement, par M. Theil,... (1847)
Petit manuel de la langue grecque, ou Recueil d'exercices gradués adaptés à la grammaire grecque de M. Theil, chaque exercice composé d'une version et d'un thème... Terminé par un double vocabulaire grec-français et français-grec. Par M. Theil (1847)
A Monseigneur l'évêque de Chartres. (5 septembre 1846.) (1846)
Discours prononcé à la distribution solennelle des prix du Collège royal de Henri IV, le 13 août 1846, par M. Theil,... (1846)
Grammaire élémentaire de la langue grecque, à l'usage des établissements d'instruction publique, rédigé sur les meilleurs travaux allemands, notamment sur ceux du Dr Raphaël Kuehner, par M. Theil,... (1846)
Grammaire élémentaire de la langue grecque... rédigée sur les meilleurs travaux allemands, notamment sur ceux du docteur Raphael Kuehner, par M. Theil,... (1846)
À Mgr l'évêque de Chartres [Mgr Clausel de Montals]. Paris, 5 septembre 1846. [Signé : Theil.] - À monsieur le rédacteur de "La Quotidienne". [Signé : Theil, 6 septembre 1846.] - À monsieur le rédacteur de la "Gazette de l'Instruction publique". [Signé : Theil.] (1846)
Recueil de morceaux choisis dans les auteurs classiques des littératures grecque, latine et française, et destinés à la récitation, par M. Theil,... (1845)
Dictionnaire complet d'Homère et des Homérides, ouvrage où l'on a résumé... tous les travaux de la critique... sur Homère, ses poèmes... par N. Theil,... et Hipp. Hallez-d'Arros,... (1841)
Discours prononcé à la distribution solennelle des prix du collège royal de Nancy, le 26 août 1841, par M. Theil,... (1841)
Court exposé du dialecte épique à l'usage des élèves qui commencent à expliquer Homère, par N. Theil,... (1840)
Candidature... Aux électeurs du département de la Seine
Dictionnaire latin-français, rédigé d'après les meilleurs travaux allemands et principalement d'après le grand ouvrage de Freund
Traducteur (14)
Dictionnaire classique de biographie, mythologie et géographie anciennes (1884)
Grammaire latine (1881)
Grammaire latine du Dr J. R. ["sic"] Madvig,... traduite de l'allemand, sur la 4e édition, par N. Theil,... (1870)
Grammaire latine (1870)
Dictionnaire de biographie, mythologie, géographie anciennes (1865)
Grand dictionnaire de la langue latine sur un nouveau plan (1862)
Grand dictionnaire de la langue latine, sur un nouveau plan (1858)
Grand dictionnaire de la langue latine (1858)
Mes prisons... 5e édition (1846)
["Deutsche Sagen".] Traditions allemandes, recueillies... par les frères Grimm... (1838)
Histoire abrégée de la littérature classique ancienne (1837)
Des Devoirs des hommes, ou la Morale du christianisme développée, par Silvio Pellico. Traduit de l'italien par N. Theil (1836)
Le galérien (1829)
Grammaire latine du Dr J. R. Madvig,... traduite de l'allemand par N. Theil. - [1]
Éditeur scientifique (10)
Notes sur la famille Theil écrites par Madame Mariano Goybet en 1926
Mon arrière grand père Theil devait appartenir à une bonne famille de la Charente ou de la Gironde : Une miniature le représente vêtu comme un grand bourgeois de l'époque.
Il entra à l'école navale , alors à Angoulème ; lorsque seuls les jeunes les jeunes gens ''biens nés'' s'y présentaient ! Etant allé à Saint-Domingue , il y connut une jeune veuve de 18 ans -J'ignore le nom du premier mari, sans doute l'un des propriétaires de l'ile- Elle appartenait à la famille Petit qui possedait un fort beau domaine travaillé par 200 esclaves, Lors de la révolte des nègres, ceux çi sauvèrent les maitres qui étaient bons pour eux.....La propriété était importante puisque lorsque le gouvernement Français paya des indemnité aux colons , soit le 60 % de la valeur , mon arrière grand père eut 1500 Francs et chacun de ses deux enfants 1200, rentes qui auraient du être reversées sur les enfants de mon grand père …. si les démarches nécessaires eussent été faites.
Mes arrières grand parents eurent là bas une fille nommée Aspasie Que j'ai connu étant enfant ,Elle ne s'était jamais mariée par amour filial,....malgré les propositions honorables qui lui furent faites. Mes arrière grands parents rentrèrent en France, mon grand aïeul quitta la marine et devint chef d'instruction à Langon Gironde, C'est là que le 13 Avril 1808 à 7 heures du matin naquit mon grand père Jean François Napoléon . Pourquoi ce prénom ? Voiçi.
Napoléon Ier traversait Langon, se rendant sans doute en Espagne – Entendant des cris d'une nature particulière, il en demanda le pourquoi ? - Sire une des dames de la ville dans un état interessant , émue de vous avoir vu, met son enfant au monde- Eh bien ! Dit l'Empereur , montez lui dire que je serai le parrain !
Mon arrière Grand père devait être quelqu'un. J'ai eu entre les mains les conseils manuscrits qu'il avait écrits pour son fils : chef d' oeuvre de morale , de style impeccable et sobre de calligraphie. Mon aîeule était fort belle, Elle vécut 92
Mon grand père commença ses études à Langon, Je sais qu'il fut toujours couvert de prix, qu'il en eut souvent au concours général et qu'à 21 ans, il était surveillant à L' École normale supérieure de Paris .Il se maria , à 23 ans, avec Mademoiselle Sophie Fougères de limoges. Il y faisait ses débats comme professeur de lettres. Ma grand mère avait pour mère une Demoiselle Martial Ardant frères : C'est la raison sociale d'une grande maison d'édition établie à Limoges depuis l'invention de l'imprimerie. Ma grand mère eut 10 enfants dont 6 devinrent grands. C'était une femme admirable non seulement comme maîtresse de maison et mère de famille, mais fort instruite, elle parlait le Latin et apprit le grec afin de corriger les épreuves d'une grammaire que mon grand père faisait éditer en cette langue, De plus adroite au possible, sachant tout faire. Le jeune ménage alla bientôt s'établir à Nancy ou mon grand père enseignait au lycée . Là étaient nés Léontine , Alfred et Clémence ma mère (les enfants nés à Limoges n'avaient pas vécu),
En tout cas, en 1842 ou 43, mon grand père fut nommé au Lycée Henri-IV à Paris , monsieur Abel François Villemain ministre de l'instruction publique , ne voulait pas qu'un homme de cette valeur reste en Province. Il est certain que lorsque Mirecourt – critique littéraire des plus mordants – analysait les œuvres de ses contemporains , seules celles de mon grand père, déjà nombreuses furent épargnées. Mes grands parents se logèrent rue d'enfer (26) en face le Luxembourg, puis dans la même rue , une autre maison dont l'une des parties donnait sur le Luxembourg. Cette seconde habitation disparut quand on ouvrit la rue Soufflot . Victor Cousin le philosophe , Lefebrise de Tourey le mathématicien en étaient les autre locataires .
A Henri IV mon grand père eut comme élèves de seconde les fils de Louis-Philippe Ier , le Prince de Joinville, le Duc D'Aumale.
.
Lorsque ce dernier commandait le 7 ème corps d’armée à Briançon , mon père étant Colonel du 109 ème à Chaumond en 1877 , il vint inspecter le régiment Je me souviens parfaitement de la visite qu’il fit à ma mère Lorsqu’elle lui dit qui elle était
« Comment s’écria t’il, vous êtes la fille de mon bon ami Theil . »
« Oui Monseigneur , nous appartenons à la 1ere noblesse, celle de l’intelligence ! . »
« Ce n’est pas moi qui vous contredirai ! »
Le duc me prit alors sur ses genoux et me caressa …..Je puis donc dire sinon, que j’ai été élevée sur les genoux des princes , au moins que j’y ai passé.
En 1848, pourtant, mon grand père étant Commandant de la Garde nationale prit part à la révolution : une gravure du temps le représente tenant sa main sur le cœur de Lamartine qui discoure à l’hôtel de ville pour prouver au peuple que celui çi dit la vérité ! …. Naïveté des images de ce temps !
Il en résulte que mon grand père fut mis à pied pendant 3 mois avec d’autres notabilités et enfermé comme elles à la conciergerie . C’est alors qu’apparaît plus que jamais la fermeté et le bon sens de ma grand-mère. Trois mois sans traitement , six enfants à nourrir … Il faut aviser. Aussitôt on prend du travail de couture dans un grand magasin . Ma mère seule qui avait 9 ans , gagnait 24 sous par jour …et 24 sous , à cette époque c’était quelque chose .
Mon grand père travailla longtemps pour Firmin Didot . Il composa des grammaires latines et grecques , la première traduction de Silvio Pellico . Il savait couramment 7 langues . c’était réellement un grand poète . C’est surtout le dictionnaire Latin Français qui est le summum de ses œuvres .Il avait de plus , la répartie la plus vive et même gauloise , vu l’héritage qu’il m’a légué et que j’ai parfois de la peine à réprimer.
En 1852 Napoléon III trouve qu’une belle intelligence unie à un tel savoir ne pouvait rester sans emploi Mon grand père fut nommé professeur au Lycée Saint-Louis ou il demeura jusqu'à sa retraite . Il se retira à Provins dans une jolie propriété où il mourut à 70 ans le 13 Aout 1876.au grand désespoir de ma mère qui l’aimait profondément .
Chose curieuse , notre oncle le Général Charles Goybet , inspecteur Général de la Cavalerie avait été en garnison à Horn et connaissait mon grand-père. Il ne se doutait pas que la petite fille de ce beau vieillard aux cheveux blancs frisés, de belle tournure , épouserait un jour son neveu à lui !
Mon grand père à eu les honneurs du Larousse qui le reconnaît comme un grand Philologue . Croyant mais peu pratiquant, il le devint sérieusement passé 55 ans .
Ma grand-mère elle, était morte le 10 Février 1864 à 48 ans . Elle avait été frappée terriblement par la mort de son fils Alfred .
Famille Theil et journal de l'officier de marine Alfred Theil ...
SEIZE MOIS DE COMMANDEMENT DANS LA GARDE NATIONALE PARISIENNE de NAPOLEON tHEIL (1849)
- Titre :
- Seize mois de commandement dans la garde nationale parisienne, mémoire justificatif adressé par M. Theil,... à ses collègues universitaires, à ses camarades de la garde nationale...Auteur : Theil, Napoléon (1808-1878). Auteur du texte Éditeur : P. Masgana (Paris) Date d'édition : 1849 . Identifiant :ark:/12148/bpt6k5683985s
- Source :
- Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LB55-1151
Contexte du livre de Napoleon Theil : Les Révolutions de 1848
La Révolution française de 1848 , parfois dénommée « révolution de Février », est la troisième révolution française après la Révolution française de 1789 et celle de 1830. Elle se déroule à Paris du 22 au .
Sous l'impulsion des libéraux et des républicains, une partie du peuple de Paris se soulève à nouveau et parvient à prendre le contrôle de la capitale. Louis-Philippe, refusant de faire tirer sur les Parisiens, est contraint d'abdiquer en faveur de son petit-fils, Philippe d'Orléans, le .
Le même jour, dès 15 heures, la Deuxième République est proclamée par Alphonse de Lamartine, entouré des révolutionnaires parisiens. Vers 20 heures, un gouvernement provisoire est mis en place, mettant ainsi fin à la Monarchie de Juillet.
Cette révolution sera suivie des Journées de Juin réprimées dans le sang (5 700 morts).
Fin de la Monarchie de Juillet (février 1848)
En décembre 1847, des gardes nationaux de Paris, inscrits dans la douzième légion, voulurent organiser un banquet réformiste avec comme revendication d'élargir le suffrage censitaire. Il fut interdit par le ministre de l'intérieur. Le journal Le National répliqua en convoquant le 22 février 1848, place de la Madeleine, toute la garde nationale, sans armes mais en uniforme, pour former une haie d'honneur aux convives. La garde nationale n'y répondit pas.
La Garde nationale mobile pendant les Journées de Juin 1848.
En février 1848, la garde nationale fut généralement passive aux combats. Après le départ de Louis-Philippe Ier, c'est principalement à la garde nationale que revint la tâche de rétablir l'ordre. Le 25 février, le gouvernement provisoire rétablissait dans tous leurs droits les gardes nationales que la monarchie de juillet avait dissoutes. Le 8 mars, un décret affirmait que « tout citoyen de 21 à 55 ans, ni privé ni suspendu de ses droits civiques est garde national et y exerce le droit de suffrage pour tous les grades d'officiers ». C'était la confirmation du suffrage universel. Le 26 mars, un décret confirmait que les officiers des gardes nationaux en province seraient élus dans les mêmes conditions qu'à Paris. Les colonels ne seraient plus nommés par le gouvernement.
La répression par la Garde nationale mobile de la manifestation du 16 avril 1848 marque un tournant : selon l'historien Samuel Hayat, celle-ci « permet [...] que s'estompent les différences entre l'armée, la Garde nationale fixe et la Garde nationale mobile : la Garde nationale y perd sa spécificité d'institution de représentation du peuple armé, pour devenir un corps armé uni, obéissant, et dédié au maintien de l'ordre »3.
Soulèvements de mai-juin 1848
Article détaillé : Journées de Juin.
L'insurrection du 15 mai 1848 vit une rupture entre gardes nationaux bourgeois et partis de gauche.
Les insurrections ouvrières de juin 1848 furent surtout réprimées par l'armée et les gardes nationaux parisiens appuyés par des gardes nationaux de province, essentiellement d'Amiens, Beaugency, Meung, Orléans, Pithiviers, Rouen, et Versailles4,5.
Pour aller plus loin:Wikipedia/ Garde_nationale_(France)
Discours à l’Hôtel de Ville du 25 février 1848
Histoire de la Révolution de 1848
Discours à l'Hôtel de Ville
25 février 1848
1833.[1]
Lamartine rejects the Red Flag before the Hôtel de Ville, depicting the 1848 Revolution
Lamartine devant l’Hôtel de ville de Paris le 25 février 1848 refuse le drapeau rouge — Philippoteaux.
Louis-Philippe 1er, Roi des Français pendant plus de 17 ans, abdique la veille devant l’insurrection parisienne. Le lendemain la foule brandissant des drapeaux rouges devant l’Hôtel de ville demande le remplacement du drapeau tricolore (officialisé par Louis-Philippe en 1830).
Lamartine, ministre des Affaires étrangères du tout jeune gouvernement provisoire, sort de l’Hôtel de ville et s’avance devant la foule en prononçant l’un de ses discours les plus percutant
« Voilà ce qu’a vu le soleil d’hier, citoyens ! Et que verrait le soleil d’aujourd’hui ? Il verrait un autre peuple, d’autant plus furieux qu’il a moins d’ennemis à combattre, se défier des mêmes hommes qu’il a élevés hier au-dessus de lui, les contraindre dans leur liberté, les avilir dans leur dignité, les méconnaître dans leur autorité, qui n’est que la vôtre ; substituer une révolution de vengeances et de supplices à une révolution d’unanimité et de fraternité, et commander à son gouvernement d’arborer, en signe de concorde, l’étendard de combat à mort entre les citoyens d’une même patrie !
Ce drapeau rouge, qu’on a pu élever quelquefois quand le sang coulait comme un épouvantail contre des ennemis, qu’on doit abattre aussitôt après le combat en signification de réconciliation et de paix. J’aimerais mieux le drapeau noir qu’on fait flotter quelquefois dans une ville assiégée, comme un linceul, pour désigner à la bombe les édifices neutres consacrés à l’humanité et dont le boulet et la bombe mêmes des ennemis doivent s’écarter. Voulez-vous donc que le drapeau de votre République soit plus menaçant et plus sinistre que celui d’une ville bombardée ?
[Ici, Lamartine fut interrompu par des discussions entre les émeutiers qui avaient envahi l'Hôtel de Ville et auxquels il s'adressait. Il reprit :]
Citoyens, vous pouvez faire violence au gouvernement, vous pouvez lui commander de changer le drapeau de la nation et le nom de la France. Si vous êtes assez mal inspirés et assez obstinés dans votre erreur pour lui imposer une République de parti et un pavillon de terreur, le gouvernement, je le sais, est aussi décidé que moi-même à mourir plutôt que de se déshonorer en vous obéissant. Quant à moi, jamais ma main ne signera ce décret. Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang, et vous devez le répudier plus que moi, car le drapeau rouge que vous rapportez n’a jamais fait que le tour du Champ-de-Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et en 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. »
SEIZE MOIS DE COMMANDEMENT DANS LA GARDE NATIONALE PARISIENNE
NAPOLEON THEIL
1849
AVANT-PROPOS.
Le présent Mémoire, quoique destiné à la justification d'un seul, ne sera pas dépourvu d'un certain intérêt général. Il renferme quelques détails précieux qui jetteront sur plusieurs points demeurés obscurs de l'histoire contemporaine un jour ou nouveau ou plus net; et, à défaut d'autre utilité, le lecteur en tirera toujours ce profit, d'apprendre, par un frappant exemple, à quel point peut s'égarer, dans les temps de discorde civile, l'ombrageux soupçon des partis.
A MES COLLÈGUES DE L'UNIVERSITÉ;
A MES CAMARADE8 DE LA GARDE NATIONALE.
MESSIEURS
La main de la justice peut s'égarer, ce qui n'arrive que trop souvent en France; mais quand elle reconnaît son erreur, ce qui malheureusement n'arrive pas toujours, il est d'un bon citoyen de ne pas trop se plaindre, et de borner le ressentiment des rigueurs subies, à faire des voeux, et, s'il a quelque puissance par la plume ou par la parole, tous ses efforts pour qu'une prompte réforme fasse disparaître enfin de noi Codes les monstruosités qui les déparent. Ainsi faisais-je. Rendu à la liberté, après quarante-cinq jours de détention préventive, je me taisais, jugeant le mal à peu près
- 4 -
réparé, du moins dans l'opinion, par l'ordonnance de non-lieu qui m'a fait élargir. Mais voici que l'autorité administrative, reprenant tout à coup la cause abandonnée par le Parquet, a désiré l'examiner à son point de vue, c'est-à-dire, voir s'il n'y aurait pas de quoi suspendre, là où il n'y à pas eu de quoi pendre. C'est un scrupule qui l'honore et dont je suis bien loin de lui faire reproche. Cité en conséquence devant le Conseil de préfecture, j'ai eu à m'expliquer de nouveau sur ma conduite-, et le Conseil, se déclarant satisfait de mes observations, m'a suspendu pour deux mois de mes fonctions de commandant. (Je donne à la fin de ce mémoire le texte de ce remarquable arrêt.)
Comme ici ce n'est plus seulement la main qui se fourvoie; comme j'ai la conscience de n'avoir pas plus mérité d'être suspendu que pendu, et que, une fois mon honneur en jeu, je ne sais plus me résigner, j'ai résolu d'en appeler, non point aux journaux , non point au pays tout entier, mais à vous, mes collègues universitaires, à vous, mes camarades de la garde nationale, dont je tiens à conserver l'estime.
C'est dans ce but que je publie le présent mémoire, destiné, dans sa forme primitive, à l'édification de mes juges du Conseil de préfecture, et, au besoin, du Conseil académique. J'ai pensé qu'en mettant au jour tous les actes de ma vie publique depuis deux ans, je fournirais à ceux qui pourraient désirer me bien connaître, un sûr moyen d'appréciation; car ma vie officielle, c'est moi tout entier. Je n'appartiens à aucune association secrète ou avouée; je ne fais partie d'aucun comité électoral ou autre; je n'ai jamais mis le pied dans un club ; mon action, par conséquent, bornée aux prises d'armes, aux revues, aux occasions solennelles, a été toute extérieure, toute en relief; absolument nulle en dehors de la représentation. J'emploie donc le seul moyen que j'aie de faire connaître mes idées et mes tendances, en appelant l'attention sur le rôle, modeste sans doute, mais non dépourvu de signification, que j'ai pu jouer, comme garde national, depuis deux ans. Veuillez parcourir avec moi toutes les dates importantes de cette période historique.
AVANT FÉVRIER.
Avant février, j'étais simple grenadier, et mon ambition n'allait pas plus loin. Une fois seulement l'idée me vint, ou plutôt me fut inspirée, de solliciter une lieutenance vacante dans ma compagnie. Voici la circulaire autographiée que j'adressai alors à mes camarades.
Monsieur et honorable camarade,
Une lieutenance est vacante dans la compagnie de grenadiers à laquelle nous avons l'honneur d'appartenir; j'ignore quels candidats se présenteront à vos suffrages. Quels qu'ils soient, je viens , sans hésiter ( car c'est ici une lutte de zèle et de dévouement public plutôt que de mérite personnel ) me présenter à votre choix.
La garde nationale est une institution si précieuse à l'ordre public qu'il est de la plus haute importance pour tous qu'elle comprenne toujours et ne méconnaisse jamais sa mission toute pacifique, toute conciliatrice.
Un excellent esprit l'anime ; mais la politique a ses éventualités, ses orages; il importe que, dans les situations difficiles, la voix des chefs se fasse entendre avec persuasion et fermeté.
Arrivé à l'âge où la maturité de l'esprit s'allie généralement à l'énergie du caractère ; père de famille, fonctionnaire public, formé par la nature même de ma profession à des habitudes de discipline et de règle, je crois offrir à peu près toutes les garanties qu'on peut désirer dans un chef de milice civique.
Peut-être me demanderez-vous mes opinions politiques ; les voici en quelques mots : Je veux, comme but, la liberté dans l'ordre et l'ordre dans la liberté. La liberté sans l'ordre, c'est l'anarchie; l'ordre, sans la liberté, c'est la servitude. Or, un bon citoyen ne veut ni l'une ni l'autre. Comme moyen, je veux la dynastie de juillet, et les institutions de juillet, mais dans leur sincérité , c'est-à-dire, avec toutes les conditions d'un progrès sage, d'un perfectionnement réel
Agréez, monsieur et honorable camarade, l'assurance des sentiments affectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être,
Tout à vous : Napoléon THEIL.
Professeur de seconde au collège royal de Henri IV. 14, rue d'Enfer.
Vous voyez, messieurs, par cette circulaire, que je ne suis pas de ceux qui prévoyaient, il y a deux ans, l'avènement de la République, encore moins de ceux qui le préparaient; à moins toutefois que les idées et les sentiments que j'ai répandus ci et là dans quelques écrits universitaires ne constituassent à mon insu une propagande républicaine et que je ne fusse ainsi républicain sans m'en douter. La chose n'est pas impossible. Beaucoup, après février, se sont tout à coup trouvés républicains de la veille, qui l'étaient à de moindres titres. Quoi qu'il en soit, la République étant survenue et tout le monde s'étant empressé de la saluer, je fis comme tout le monde, je l'acceptai, mais sincèrement, sans arrière-pensée, comme une heureuse promesse, comme une douce et sainte espérance qui souriait à mes voeux de bon citoyen. Revenons à ma circulaire ; elle n'eut aucun succès, car j'étais fonctionnaire public, et les fonctionnaires en ce moment n'étaient pas en faveur. Sans cette détestable note que j'avais invoquée, dans ma bonhomie, comme une puissante recommandation, j'étais lieutenant d'emblée. Je restai grenadier, ne voulant pas cesser d'être fonctionnaire. Étrange renversement! j'étais suspect alors à la garde nationale comme employé du gouvernement; aujourd'hui je suis suspect au gouvernement comme officier de la garde nationale. Ma vocation, je le crains bien, est d'être suspect sous tous les régimes.
Le pont de l'Archevêché gardé par des troupes pendant la révolution de 1848 - Musée Carnavalet.
Février 1848.
Février arriva donc. Mon rôle, messieurs, dans les deux journées qui changèrent si inopinément la forme du gouvernement de la France, n'eut rien de particulièrement saillant; il fut tout bonnement celui d'un honnête et paisible citoyen qui déplore la guerre civile, quelle que soit la cause qui la provoque, et dont la première pensée est et sera toujours d'arrêter le plus tôt possible l'effusion du sang. M. Boulayde la Meurthe, alors colonel de la 11e légion, aujourd'hui vice-président de la République, pourrait vous dire, s'il a bonne mémoire et je crois qu'il se souvient assez , quel plan de pacification, conçu par moi et adopté par lui, allait être mis à exécution au moment où nous fut apportée la nouvelle de l'abdication du roi et de l'établissement d'une régence. Il pourrait vous dire aussi avec quel sentiment de bonheur cette nouvelle, qui avait tout à coup fait taire la voix du canon, fut généralement accueillie dans nos rangs. Quant à moi , je vous le confesse, dussé-je me compromettre sans retour, j'en versai des larmes de joie. C'est ce que me rappelait, il y a quelques jours, l'ancien chef de ce bataillon, M. Tilliard. Convenez-en, on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre, le matin du 24 février, à la République pour le soir.— Sont-ce là tous mes souvenirs personnels se rattachant à cette époque? Non; il en est un qui ne s'effacera jamais de ma mémoire, bien qu'il paraisse s'être beaucoup obscurci dans celle du personnage éminent, héros immortel de la scène que je vais vous raconter.
LAMARTINE ET LE DRAPEAU ROUGE.
C'était le 25 février. Mon service fait à la mairie, j'étais allé, mon fusil sur l'épaule (car, en ces jours de confraternité militaire, un fusil laissé au corps-de-garde est toujours un fusil perdu), voir ce qui se passait du côté de l'Hôtel-dc-Ville. Il s'y passait des choses effrayantes. La foule, profondément agitée, demandait la substitution du drapeau rouge au drapeau tricolore. Des cris de mort, dirigés surtout contre M. de Lamartine qu'on appelait légitimiste, carliste, henriquinquiste, s'élevaient de toutes parts, et les flots toujours plus compactes, toujours plus furieux de cette multitude ondoyante allaient battre les grilles ébranlées, les grilles mal défendues de l'hôtel. Je frémis à ce spectacle. J'essayai, dans quelques groupes, de défendre le drapeau tricolore et M. de Lamartine. Mais mon éloquence faillit me coûter cher. « Qu'il vienne donc , votre Lamartine (votre Martine, disaient d'autres), proclamer devant nous la République ! Mais il ne le fera pas ! Il aurait peur que ça l'étrangle ; mais il n'y perdra rien ; car il sera étranglé tout de même; et vous aussi, si vous continuez à nous emb... » Effrayé de ces dispositions de la foule, je résolus de parvenir, à tout prix, auprès de M. de Lamartine et de le prévenir. Deux heures je luttai pour arriver jusqu'à la grille, espérant, grâce à mon uniforme, pouvoir pénétrer dans l'intérieur. Impossible. L'idée me vint enfin de tenter l'entrée par la porte opposée. Je m'y rendis. Elle était également assiégée, également inabordable. Par bonheur, un détachement de gardes nationaux, grenadiers comme moi, vint à passer, conduisant à l'Hôtel-de-Ville je ne sais plus quel convoi. Je me mis à la suite et franchis le seuil. Mais je n'étais pas au bout de mes fatigués. Il fallait arriver jusqu'au siège du gouvernement. Or, l'escalier qui conduisait à ce sanctuaire, était formidablement gardé par des sentinelles de tout costume et de toute
— 6 —
couleur, par des élèves de toutes les écoles, et nul ne montait sans un laisser-passer C.IÏ bonne forme. J'eus beau (selon le conseil de mon camarade; car j'avais un camarade, venu avec moi de la mairie du 11e, mais dont le nom m'échappe), j'eus beau, dis-je, prétexter une mission du maire de mon arrondissement, la. garde fut inexorable. En toute autre circonstance, j'aurais renoncé à mon entreprise ; mais au pied même de cet escalier, assiégé par une masse de personnes de toute condition , les discussions sur le drapeau rouge se continuaient avec fureur : les mêmes cris de mort se faisaient entendre ; je persévérai. Bien m'en prit; car un instant après, trompant la vigilance des gardes, je pus me glisser jusqu'au premier étage, dans une petite salle pleine comme un oeuf, et sur laquelle s'ouvrait une sorte de guichet par où les membres du gouvernement provisoire venaient haranguer le peuple, c'est-à-dire les délégués introduits. Au moment où j'arrivai, M. de Lamartine était justement à ce guichet, cherchant à se faire entendre, mais n'y pouvant réussir. Sa voix, dès qu'il ouvrait la bouche, était couverte par les cris d'un jeune homme qui tenait à la main ou au bout d'un fusil une pétition où on lisait en grosses lettres : Organisation du travail. Ce jeune homme voulait à toute force être introduit dans la salle même des séances du gouvernement. Le tumulte ne faisant qu'augmenter, M. de Lamartine se retira, et la foule désappointée se mit en devoir d'enfoncer la cloison. L'indignation me saisit. Je pénétrai, en me faisant jour à coups de crosse sur les pieds de mes voisins, jusqu'à cette cloison et mettant mon fusil en travers : on ne passe pas, criai-je. Quelques furieux essayèrent de m'arracher mon fusil. Prenez garde, leur dis-je; il est chargé de trois balles, et, comme j'avais la main sur la détente, la foule, chez qui domine toujours l'instinct de la conservation , s'écarta aussitôt. En ce moment parut au guichet un nouvel orateur, qui espérait être plus heureux que M. de Lamartine. C'était Louis Blanc. Mais, à son arrivée, la même scène recommença : Laissez passer, criait-on, la pétition pour l'organisation du travail.' Place à la pétition! Et la foule s'ébranlait, et tous les efforts réunis se portaient vers la cloison. Elle allait céder, quand un ouvrier, enlevant dans ses bras vigoureux le jeune orateur prêt à se retirer aussi, le présenta à la foule et, grâce à l'aide que je lui prêtai, le maintint au-dessus de toutes les têtes, réclamant pour l'ami des travailleurs quelques instants de silence. On fit silence. Louis Blanc, visiblement ému d'abord, se remit par degrés ; sa parole bientôt devint nette, ferme, éclatante; sa phrase même eut quelque chose d'académique dont je fus frappé. Quelle fut la substance de son discours ? Des promesses, si je m'en souviens bien , en composaient tout le fond. Pour la foule c'est beaucoup. L'effet fut prompt ; le calme se rétablit et de vifs applaudissements suivirent l'orateur dans sa retraite. Comme je le portais, je fus nécessairement de sa suite et je pus, grâce à cette circonstance, pénétrer jusque dans ce long corridor où fonctionnait l'imprimerie du gouvernement, fabriquant force décrets, et où Lagrange, gouverneur de l'Hôtel-de-Ville, allait et venait, suant, soufflant, fort affairé et agité. Je fus arrêté à la porte du fond par un factionnaire garde national. Je me mis en faction à l'autre battant de cette porte et j'attendis. Au bout d'une demi-heure, mon homme s'étant absenté, je pus m'insinuer jusqu'à l'entrée d'une seconde pièce, antichambre du gouvernement provisoire, dans laquelle siégeait M. Flottard, aujourd'hui conseiller de préfecture, à qui je dois peut-êlre un de mes deux mois de suspension , sinon tous les deux. (Ces vieux républicains sont très-rigides en fait de discipline, surtout quand ils croient voir poindre à l'horizon le spectre de la monarchie). Je trouvai en faction à cette porte et faisant son service avec une sévérité remarquable , le citoyen Malefille, alors rédacteur du National, et naguère ambassadeur de la République en Portugal. Je lui demandai sa consigne et m'associai à sa dure besogne, en attendant l'arrivée de M. de Lamartine, à qui j'avais fait dire par M. Carnot, je crois, qu'on le demandait pour une communication importante. Il parut enfin. J'allai à lui, je lui exposai la gravité de la situation, et comme en ce moment la foule qui encombrait la petite pièce au guichet, poussée en avant par le flot populaire qui montait toujours, venait d'envahir la longue salle que longe le corridor, je l'y entraînai avant qu'il eût eu le temps de se reconnaître, sûr de son triomphe , s'il parlait. Je lui présentai une chaise; il y monta et, le silence s'étant fait, il prononça cette magnifique harangue, dont Lagrange, écho un peu bruyant, transmettait quelques lambeaux par une fenêtre à la foule pressée dans la cour. Ce que j'avais prévu arriva. Le peuple subit l'ascendant de cette magique parole. Mais si l'enthousiasme était au comble dans cette salle, il y avait sur la place même de l'Hôtel-de-Villeune autre foule dont les vociférations parvenaient jusqu'à nos oreilles: c'était celle là qu'il fallait surtout calmer. L'orateur,satisfait de son succès, se disposait à
- 7 —
rejoindre ses collègues ; mais je le tenais par le bras et lui déclarai que je ne le lâcherais point qu'il n'eût paru au balcon et remporté un nouveau triomphe. Il hésitait; je l'entrainai. Arrivé là, il monta sur un fauteuil, fit signe de la main qu'il allait parler, parla, et le seul mot de république, descendu de ses lèvres sur la foule attentive, suffit pour changer la Colère en ivresse, les cris de mort en frénétiques acclamations. Cependant que faisais-je? mon rôle de grenadier, représentant de la garde nationale. Pendant tout le temps que parla M. de Lamartine, je fus à côté de lui, mon énorme bonnet à poil sur la tête, ma main gauche placée sur le canon de mon fusil, la main droite appuyée sur la poitrine de l'orateur. Pourquoi cette altitude? quelle inspiration me la faisait prendre? Sans doute j'avais compris instinctivement que, lorsqu'un orateur suspect à la foule prend la parole devant elle en de si critiques conjonctures, il est bon que les battements de son coeur, interrogés et pris en quelque sorte à témoin, répondent de la sincérité de son langage.
Ce même jour, à six heures du soir, je fus chargé de porter, de l'Hôtel-de-Ville au ministère de l'intérieur, une dépêche qui donnait l'ordre à je ne sais quel officier d'aller, avec son détachement, prendre au Palais-Royal, pour la transporter de là au Trésor, une somme de vingt millions, trouvée dans les caisses de la liste civile, ainsi que des diamants. Comme j'étais exténué de fatigue et mourant de faim, je remis la dépêche à un élève de Saint-Cyr, messager de l'Hôtel-de-Ville, que je rencontrai à cheval devant la mairie du dixième arrondissement.
Tels sont , messieurs, mes souvenirs de grenadier, et la part que j'ai prise comme tel à la révolution de février. En juillet 1830, j'avais, pour tout exploit, sauvé deux Suisses de la caserne Babylone, ce qui m'avait rendu, je l'avoue, plus heureux et plus fier que si j'en eusse tué dix. En février 1848, j'ai ravagé ma garde-robe pour déguiser trois gardes municipaux de la caserne des Célestins, pris à la préfecture de police et dirigés sur la mairie du onzième arrondissement; de plus, j'ai un peu contribué, vous avez vu comment, à sauver le drapeau tricolore et peut-être M. de Lamartine. Je crois qu'il y a progrès, et qu'on ne peut guère se refuser à voir en moi déjà un garde national sauveur, sinon conservateur.
1833.[1]
Lamartine rejects the Red Flag before the Hôtel de Ville, depicting the 1848 Revolution
Lamartine devant l’Hôtel de Ville de Paris le 25 février 1848 refuse le drapeau rouge
| Peintre Henri Félix Emmanuel Philippoteaux (1815–1884) |
|---|
Avril 1848. — Commandant.
J'arrive au commandant, qui seul est mis en cause. Ma nomination, messieurs, date des élections générales. Lorsqu'elles eurent lieu, au commencement d'avril, j'étais à Limoges, chargé par M. Carnot, ministre de l'instruction publique, d'une mission toute de confiance. C'est dire que si par hasard l'intrigue, qui se glisse partout, a eu, ce que j'ignore, quelque part à mon élection , je dois en être fier; car l'intrigue désintéressée, officieuse, est fort rare; elle est un hommage à celui à qui elle profite, et il est beau de faire mentir le proverbe : les absents ont tort. Il est vrai que ce qui m'arrive pourrait le justifier. Peut-être, en effet, présent ne m'eût-on pas élu; ce qui m'eût épargné le double désagrément d'une détention de six semaines et d'une suspension de deux mois; mais il était écrit sans doute que je passerais par ces deux épreuves, et c'était là le but providentiel de ma mission.
Mission à limoges.
Pourquoi ne vous parlerais-je point, en passant, de cette mission ministérielle qui se rattache d'une façon si étroite à ma destinée militaire? Laissez-moi vous en dire deux mots; elle ne manque pas d'originalité.
Ma mission à Limoges, messieurs, était d'aller pacifier le lycée où de graves désordres avaient eu lieu, à la suite et à l'imitation de ceux du lycée de Poitiers. Pacifier! étrange début, direz-vous, pour un futur conspirateur. Croyez-moi pourtant, rien n'allait mieux à mon caractère. Aussi mon intervention fut-elle couronnée d'un plein succès. Quelques mots paternellement sévères, mais qui n'avaient, je l'avoue, rien de pédant, suffirent pour faire rentrer dans le devoir ces jeunes gens égarés. Leur soumission fut si prompte, si entière, que je voulus les en récompenser par une fête de famille. Quelle fut cette fête de famille et d'où m'en vînt l'idée ? Je le donnerais à deviner en mille à l'éminent Prélat qui, avant février, sur un simple fragment de discours, m'a foudroyé comme impie, et aux modérés qui, aujourd'hui, sur le bruit de mon arrestation, m'anathématisent sans doute comme républicain forcené. Écoutez bien ceci : J'avais appris, par les détails qui me furent donnés sur la marche de l'esprit public à Limoges, que, dans toutes
les solennités populaires, le clergé avait été laissé à l'écart. J'en fus affligé; car, selon moi, la République, la vraie, la bonne , celle qui me sourit, n'exclut aucun de ses enfants; elle les groupe tous avec le même amour autour de son giron maternel, et elle ne souffre pas que ce qui est fête pour les uns puisse être deuil pour les autres. Je résolus de réparer ce fâcheux oubli, et j'imaginai, dans ce dessein, de faire planter, dans la cour du lycée, un mai que le clergé serait appelé à bénir. Représentant d'un ministre, j'étais omnipotent ; la cérémonie eut lieu avec tout l'éclat convenable, et voici l'allocution que je prononçai à celte occasion. Homme d'ordre, je conserve mes discours :
Jeunes gens,
Pour sceller votre réconciliation avec vos excellents chefs, pour célébrer votre retour à l'ordre et à la discipline , je vous ai promis une fête de famille. Je tiens parole. Une fête patriotique , n'est-ce pas aujourd'hui une fête de famille, une fête de frères?
La cérémonie qui nous rassemble a un sens profond. Je désire que vous en soyez pénétrés. Cet arbre que vous plantez , c'est une pensée que vous gravez dans votre mémoire; c'est un monument destiné à vous rappeler sans cesse, au milieu de vos jeux les plus folâtres, le souvenir et en quelque sorte l'image de la patrie. La patrie française vient, comme cet arbre, d'être transplantée sur un sol nouveau, le sol de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Comme cet arbre, elle a besoin de croître et de se fortifier. Toutefois, la similitude n'est point parfaite. Cet arbre transplanté trouvera naturellement dans la terre les sucs nourriciers qui alimentent la sève ; l'air lui apportera de lui-même les éléments vitaux qu'il recèle; en un mot, il croîtra sous les seuls auspices, sous la seule influence de la nature, sa mère. Il n'en est pas ainsi de la patrie; pour grandir, pour se développer, pour acquérir le degré de force et de puissance que ses destins lui promettent, elle a besoin du concours de tous ses enfants. C'est en elle-même, en elle seule, qu'elle doit puiser les éléments de sa force et de sa vie.
Comprenez-vous, jeunes gens, le sens de cette fête symbolique ? Cet arbre est là pour vous dire sans cesse : travaillez, enfants: cultivez votre intelligence; développez par la culture intellectuelle et morale les riches facultés, les nobles instincts que Dieu a déposés dans vos âmes; devenez de bons citoyens, c'est-à-dire des hommes éclairés, moraux, religieux, laborieux. C'est ainsi que vous féconderez le sol de la patrie ; c'est ainsi, et seulement ainsi, que vous parviendrez à former, selon le voeu de la République, une nation d'hommes vraiment libres, vraiment égaux , vraiment frères.
Et vous, ministres de l'Évangile, dont la mission est ici-bas de prier et de bénir, appelez sur cet arbre, emblème de la France nouvelle, les bénédictions de celui sans qui rien ne saurait croître et prospérer sur la terre. Je suis heureux de voir la religion s'associer à l'oeuvre de régénération qui commence en ce moment. Ce concours est à la fois pour elle une sanction et un gage d'avenir. Je vous en remercie au nom de la République.
Après moi, M. l'abbé Gattrez, recteur de l'Académie, M. Delor, curé de Saint-Pierre, M. Ubertin, proviseur du lycée, prirent successivement la parole et dirent d'excellentes choses. Bref, tout se passa le mieux du monde, et un bon exemple avait été donné.
Mais là ne se borna point mon intervention pacifique. Limoges se trouvait dans une situation cruelle. Deux clubs rivaux, entre lesquels se partageaient les sympathies de la population, s'observaient avec colère et une collision était imminente. C'était là, comme ailleurs, l'éternelle querelle de l'ouvrier et du bourgeois. On tremblait. Or, j'avais des amis, des camarades d'enfance dans les deux camps; je n'étais compromis dans la querelle par aucun antécédent ; j'étais dans d'excellentes conditions pour le rôle de conciliateur : je le pris. Je me présentai dans les deux réunions, porteur de bonnes paroles, et je reçus mission, des deux parts, de négocier une paix honorable. La tâche était délicate; elle demandait force ménagements, beaucoup de discrétion, de patience et d'activité. Je fis de mon mieux ; voici la circulaire que j'adressai aux habitants :
Habitants de Limoges,
Souffrez qu'un enfant du pays, dont le coeur fut toujours avec vous, vous adresse, à la veille d'un grand acte de souveraineté nationale, quelques paroles de conciliation et de paix.
La France est enfin délivrée du joug odieux qui pesait sur ses destinées ; la monarchie n'est plus; nous l'avons brisée , et tous les peuples, à notre exemple, se lèvent pour s'affranchir. Le jour approche où l'humanité, rentrée dans les voies providentielles,ne formera plus qu'une seule et même famille. Déjà l'édifice d'union, de charité et de paix qui doit l'abriter tout entière, surgit du sol; et ces mois de Liberté, d'Égalité, de Fraternité, que la France, éternelle initiatrice des nations, a inscrits sur son glorieux drapeau, seront bientôt, sur toute la terre, de vivantes réalités.
Plein de ces pensées consolantes , ivre d'enthousiasme et d'espoir, le coeur tout ému de
l'admirable spectacle qu'offre au monde, en ce moment, l'héroïque population de Paris, je
suis venu parmi vous remplir une mission de confiance dont m'a chargé le ministre de l'inslruction
Heureux de revoir ma ville natale , après une révolution si belle, pressé
de mêler ma joie à celle de mes amis d'enfance, je suis accouru, négligeant volontiers des intérêts pour des affections
Le dirai-je? à peine entré dans vos murs, j'ai senti mon coeur se serrer ci la tristesse succéder à ma joie. Vainement je cherchais autour de moi l'enthousiasme , l'élan , l'animation calme et confiante de la capitale ; une cité morne, inquiète, voilà ce qui s'offrait à mes regards ; je ne retrouvais plus l'image de ce que je laissais.
Pourquoi, chers concitoyens, pourquoi, dans votre ville, cet aspect désolé? Dans ma douloureuse surprise, j'ai interrogé vos coeurs, j'ai sonde votre pensée, et tous je vous ai trouvés unanimes. Tous , vous vous réjouissez de la chute du régime monarchique ; tous , vous avez salué avec la même espérance l'avènement de l'ordre nouveau ; vous n'avez tous qu'un même voeu; toutes vos poitrines battent à l'unisson. Pourquoi donc, je le répète, cette profonde tristesse? Pourquoi, lorsque l'aurore d'une civilisation nouvelle, objet de vos communs désirs, commence a poindre sur l'horizon de votre pairie , ne vous unissez-vous point dans une joie commune? Qui peut paralyser ainsi l'élan de vos âmes, arrêter votre industrie, suspendre, vos transactions commerciales?
Citoyens, je vais vous le dire , car j'ai mis le doigt sur votre plaie. Vous êtes tristes, parce que vous vous méconnaissez mutuellement, parce que vous ignorez jusqu'à quel point vos âmes sympathisent, jusqu'à quel point vos volontés sont d'accord. Vous êtes sous l'empire de préventions injustes. Des souvenirs d'un autre temps importunent voire imagination, et vous empêchent d'apprécier avec justesse le caractère de voire époque, la profonde différence des idées, des sentiments et des moeurs; et il arrive ainsi que des hommes qui n'ont qu'un seul drapeau, qu'une seule et même devise, se retranchent dans deux camps, comme deux armées ennemies.
Il est temps, citoyens, de mettre un terme à ces funestes malentendus, de dissiper ces préventions déplorables. Pour vous unir, que faut-il? quelques minutes de contact et de libre effusion Entrez donc en communication, mêlez-vous, touchez-vous ; vous êtes plus semblables et plus frères que vous no le croyez.
Oui, bourgeois, vous reconnaîtrez que ces ouvriers dont on cherche à vous épouvanter ont de belles et grandes âmes ; sous la rudesse des formes et l'aspérité du langage, vous trouverez les sentiments les plus généreux, les aspirations les plus nobles; vous serez étonnés des trésors de patience, de résignation, de dévouement, de courage, que recèlent ces natures souvent incultes.
Et vous, ouvriers, je vous le dis : Ces bourgeois qu'on vous a signalés comme des égoïstes, comme des tyrans, heureux de vous exploiter et de vivre de vos sueurs, ces bourgeois ont, comme vous, des entrailles. Eux aussi ont au coeur ce que Dieu donne à tout homme en l'animant de son souffle, je veux dire un foyer d'amour et de charité; tous se sentent sollicites par de brûlantes sympathies; tous sont également impatients de réaliser l'Egalité et la Fraternité. Mais, comme vous, ils sont enlacés par des liens qu'il faut dénouer ei non briser ; et, comme vous, ils disent, dans une mortelle angoisse : Que faire pour y arriver sans secousse, sans cruels désastres, sans sacrifices humains? Question terrible qui se dresse devant tout comme un fantôme et qui cessera d'être menaçante quand vous l'envisagerez avec calme, union et ferme volonté.
Ouvriers et bourgeois, vous le voyez, ce qui vous divise, ce n'est pas le coeur ; par le coeur, vous êtes déjà frères. Ce qui vous divise , c'est la vicieuse organisation des choses. Unissez vous donc pour la changer pacifiquement, pour aviser de concert aux moyens de déblayer ce qui reste encore des débris du vieux monde, et construire le inonde nouveau.
Au nom de la France qui a tant besoin de consolider son oeuvre et de développer sa conquête; au nom de l'Europe, qui a sur nous les yeux fixés, et attend de notre altitude son salut ou sa perte ; au nom de l'humanité tout entière, intéressée à la concorde, à l'entente de tous les membres de la famille française; au nom du présent, au nom de l'avenir, citoyens de Limoges, fraternisez ! Venez confondre dans une sorte de communion patriotique vos voeux, vos espérances et vos joies; qu'une fête solennelle vous rassemble lous autour d'un symbole d'union et de paix. Contribuez par ce noble exemple à fonder plus étroitement que jamais l'unité française , première assise de l'unité européenne. Par là vous assurerez la sécurité, la prospérité du présent, vous préparerez les voies de l'avenir.
Quant à moi, qui vous adresse ces paroles sorties du coeur, je serai heureux, si je puis, en quittant votre cité rendue au calme et à la joie , aller dire à vos frères de Paris qu'ils n'ouï pas le privilège du patriotisme et que vous êtes en tout dignes d'eux.
Napoléon THEIL.
Cette espèce de proclamation, répandue à dix mille exemplaires, produisit sur les esprits un heureux effet. Le sentiment de paix dont j'étais animé se communiqua rapidement à la population tout entière. Les clubistes les plus rebelles, pris à part et catéchisés à huis clos; furent ébranlés. La fusion tant désirée allait enfin s'opérer, lorsque arriva de Paris un délégué du club des clubs, dont la malencontreuse présence gala tout. J'aurais lutté contre cette influence funeste, et triomphé, je n'en doute pas, si j'avais pu prolonger encore mon séjour à Limoges. Mais ma mission avait une limite, mon budget aussi; je dus partir.
1.
— 10 —
17 avril. — les ouvriers du Champ-de-Mars».
De retour à Paris le 17 avril, huit jours après ma nomination de commandant, on eût dit que j'arrivais tout exprès pour entrer en exercice, même avant d'être équipé. A peine en effet avais-je eu le temps d'embrasser ma femme et mes enfants , que déjà j'étais à la tête de mon bataillon , qui fut longtemps sans soupçonner ma présence; et plus d'un se demanda quel était ce personnage qui, un bonnet de police sur la tête et le briquet à la main, marchait flanqué de. l'adjudant-major, avec l'air du commandement. C'est que ce jour là l'Hôtel-de-Ville était menacé, disait-on, par deux cent mille ouvriers réuni» au Champ-de-Mars, et il n'y avait pas un moment à perdre. C'était heureusement une fausse alerte. Mais vous voyez, messieurs, que, quand le devoir m'appelle, je met» volontiers de côté non-seulement les excuses les plus plausibles, mais, ce qui a peut être bien aussi son mérite, la coquetterie du métier. Car, ce jour-là, je vous l'assure, je n'étais pas un brillant commandant.
18 avril. — Club de la Jeune-Montagne.
J'ai dit en commençant que je n'avais jamais mis le pied dans un club. Je me suis trompé. Quelques jours avant les élections, lorsque la fermentation excitée dans les esprits par l'approche de cette solennelle et décisive épreuve était au comble, et qu'à tous les coins de rue, sur toutes les places publiques, se faisait une active et ardente propagande, il m'est souvent arrivé d'aller me mêler à ces clubs en plein vent et d'y prendre la parole, pour rectifier mainte idée erronée que la foule semblait accueillir avec faveur, pour ramener l'auditoire exalté à des sentiments plus pacifiques, plus fraternels ; il m'est arrivé même de paraître dans un club proprement dit. Ce que j'y vis, ce que j'y fis mérite d'être raconté. Il y avait, rue Neuve-des Poirées, au rez de-chaussée du bâtiment des concours, un club appelé, je crois, club de la Jeune-Montagne. Ce club, présidé par un citoyen Michelot (Juin-d'Allas), que la justice criminelle a depuis revendiqué comme un de ses hôtes légitimes, était la terreur du quartier. Les motions les plus incendiaires y étaient constamment à l'ordre du jour, et malgré le profond dégoût qu'inspiraient à tout le monde les discours qui s'y débitaient, nul n'osait élever la voix dans ce pandémonium révolutionnaire. Je fus tenté de voir ce qui s'y passait, et un soir, le 18 avril, je crois, je m'y rendis. J'y fus témoin d'une scène admirable. On agitait, ce soir là, la question de savoir s'il ne fallait pas, par une manifestation imposante, obtenir que l'époque des élections fût reculée et, de plus, qu'aucune troupe n'entrât dans Paris. La manifestation était tout organisée pour le lendemain ; il s'agissait d'engager la population du club à s'y rendre. La cause du désordre paraissait gagnée, lorsque tout à coup parurent à la tribune deux jeunes gens, membres d'un club voisin, et venus à celuici eu visiteurs. L'un d'eux demanda la parole et l'obtint, non sans difficulté. Il se mit à combattre avec énergie, et dans un langage aussi élégant que facile, les deux motions dont le succès paraissait assuré. L'étonnement, la colère s'empare du bureau; le président déclare qu'on ne peut pas entendre plus longtemps un orateur qui manque au respect dû à l'assemblée et qui veut tromper le peuple. A ces mots, le jeune homme se retourne, et, apostrophant directement le président : « Tromper le peuple, dites-vous ; oui, vous avez raison; quelqu'un ici veut tromper le peuple, et ce quelqu'un, c'est vous! c'est vous qui, pour mieux l'abuser, pour vous jouer plus sûrement de sa simplicité, de sa candeur, affectez de vous dire ouvriers. Ouvriers, vous! vous mentez! jamais vous ne l'avez été. Montrez vos mains! ou plutôt, qu'ai-je besoin de vos mains? ma preuve, c'est le langage que vous venez de tenir, ce sont vos calomnies contre l'armée. Jamais un ouvrier n'eût parlé, comme vous l'avez fait, de ses braves frères qui sont sous les drapeaux ! Vous n'êtes, vous, que des artisans de discorde et de guerre civile ! et je vous dénonce ici comme tels! justifiez-vous I » A cette foudroyante apostrophe, le président restait muet, anéanti ; il était pâle; ses lèvres tremblaient; un silence profond régnait dans toute la salle. Il se lève enfin, et, d'une voix altérée : « Citoyens, dit-il, permettrez-vous qu'on insulte impunément votre président? » Personne ne bougeait, ni ne répondait ; on n'entendait qu'un léger frémissement dans l'auditoire. Le jeune homme était resté à la tribune, et, les bras croisés sur la poitrine, la tête haute, attendait. Sur un signe du président, quelques hommes qui se trouvaient au pied de la tribune se jettent sur lui; le saisissent par ses vêtements et le précipitent. Ils allaient lui faire un mauvais parti, et ce ne fut qu'un cri dans toute la salle; mais aussitôt plusieurs jeunes ouvriers, membres du club, s'élancèrent, l'arrachèrent de leurs mains, et lui faisant un rempart de
— 11 — leurs corps : « Arrière ! crièrent-ils; respect à la liberté de la tribune! » Ils firent retirer l'imprudent orateur dans un coin de la salle, où il demeura sous leur protection. Cependant je m'étais élancé moi-même, et demandai à parler. Le bureau refusait ; mais un personnage mystérieux, un vieux montagnard qui se promenait, l'écharpe au bras, dans l'allée ménagée au milieu de la salle, fit signe qu'il fallait m'entendre. On m'entendit. Je repris la thèse du jeune orateur, mais avec plus de ménagements dans la forme ; je supposai au bureau les meilleures intentions; mais, tout en reconnaissant sa bonne foi, je devais lui faire remarquer qu'il se trompait, et que ce qu'il regardait comme des mesures salutaires pouvait avoir pour le pays les conséquences les plus désastreuses. Je m'adressai, en plaidant la cause de l'armée, à tout ce que le coeur du peuple renferme de noble et de généreux. Je fus compris, et quand je descendis de la tribune, après avoir été vivement applaudi, chacun me pressait la main en disant : « Vous avez raison, citoyen ; nous n'irons pas à la manifestation. » Je fus arrêté au passage par le vieux montagnard; il me serra la main à me la briser pendant près de cinq minutes, me félicitant tout bas et à l'oreille; car il avait une extinction de voix. C'était, disait-il, la cinquième nuit qu'il passait blanche, son service à l'Hôtel-de-Ville étant on ne peut plus pénible. Ce montagnard, je le revis deux jours après, le 20 avril, au pied de l'arc de triomphe, à cheval et caracolant dans le cortége du gouvernement provisoire. Qu'était devenu, demanderez-vous, le courageux jeune homme, et qui était-il? Ce jeune homme, messieurs, avait pu s'esquiver pendant mon discours : c'était un élève de l'École normale, aujourd'hui professeur; il s'appelle Clémencet. Vous voyez, messieurs, que l'Université n'est pas toute composée de boute-feux, et qu'elle a dans son sein des missionnaires de paix qui savent élever la voix quand la tempête gronde.
20-21 avril
Le 20 de ce même mois, jour de solennelle revue, j'étais équipé de pied en cap , conformément à l'ordonnance. Ce jour-là, messieurs, mon rôle fut entièrement passif, et je n'ai rien à vous signaler, sinon que, après avoir été mouillé jusqu'aux os par la pluie fine qui tomba dans la matinée, je restai dix-sept heures à cheval, au pied de l'estrade de l'Arc-de-Triomphe, sans descendre, sans boire ni manger; il est vrai que j'étais ivre d'enthousiasme, et qu'on ne sent guère l'aiguillon de la faim quand on voit défiler devant soi 300 ou 400,000 hommes en armes, saluant avec des transports de joie et fies chants d'allégresse l'aurore d'une ère nouvelle, toute de paix et de fraternité. On croyait cette ère enfin venue; ce n'était, espérons-le, qu'une erreur de date.
73e de ligne. — MARÉCHAL Ney.
C'est, je crois, le lendemain de cette journée que se noua, au milieu de la bière et du punch, le lien de fraternité qui devait unir la 11e légion et le brave 73e de ligne, dont un bataillon était venu à Paris recevoir le drapeau. Une scène touchante et tout à fait improvisée signala le départ de ce bataillon retournant à Blois. Beaucoup de gardes nationaux avaient voulu lui faire la conduite. C'est moi qui commandais le cortége. Arrivé dans la rue d'Enfer à la hauteur de l'avenue de l'Observatoire, un souvenir me frappa ; je songeai à 1815 et à cet humble monument qui, solitairement adossé au mur de la Chartreuse, reçoit de temps en temps le culte discret de quelque vieil invalide, apportant pour offrande une prière avec un bouquet d'immortelles. Je donnai aussitôt les ordres nécessaires pour que la colonne, dirigée de ce côté, allât se ranger en bataille devant l'emplacement funèbre. Après avoir fait présenter les armes et battre aux champs : «Soldats, m'écriai-je, c'est ici qu'il y a trente-trois ans, l'illustre maréchal Ney, surnommé le brave des braves par les soldats de l'empereur, a été fusillé sans pitié. Son crime était de n'avoir pas su résister à la puissance des souvenirs, à l'entraînement de la reconnaissance et de l'amitié, au prestige vainqueur du nom de Napoléon. La restauration a flétri celte grande renommée militaire; il appartient à la République de la réhabiliter. Soldats! genou, terre! Drapeau sans tache, drapeau vierge de la République nouvelle, incline-toi devant ce monument d'un des plus nobles fils de la France. Gloire, gloire immortelle à la mémoire de Ney ! »—Messieurs, ne jugez pas avec le sang-froid de notre époque blasée les inspirations de ce temps-là!— La colonne se releva émue jusqu'aux larmes, reprit, silencieuse et recueillie, sa marche un moment interrompue, et ne sortit de la méditation où elle paraissait plongée qu'à la barrière de la Glacière, où les chants patriotiques, entonnés d'une commune voix, firent succéder à la morne tristesse des impressions récentes les joyeux élans de l'enthousiasme. A Gentilly, le cortège s'arrêta,
- 12 —
et les adieux pleins d'effusion se firent autour d'un tonneau de vin qu'une souscription improvisée avait, en quelques minutes, fait dresser en plein air, et que d'officieux échansons, prodigues avec discernement, vidèrent en moins d'une heure, sans qu'il résultât de ces libations fraternelles d'autre ivresse que celle de la joie.
1er mai. — BLOIS.
Nous nous quittâmes, mais pour bientôt nous revoir; car les officiers du détachement, avec lesquels nous avions déjeuné le matin , nous avaient fait promettre d'être à Blois le même jour qu'eux pour assister à la réception du drapeau. Accompagné de neuf camarades , pour lesquels j'avais obtenu le passage gratuit sur les chemins de fer d'Orléans et de Tours, j'arrivai au rendez-vous le jour dit et à l'heure même où le bataillon, porteur du glorieux étendard, faisait en ville son entrée triomphale. Le régiment et la garde nationale, prévenus de noire départ, nous attendaient. Dire la joie, l'effusion qui signalèrent et cette entrevue, et les fêtes qui, pendant trois jours, se succédèrent à Blois en notre honneur, n'est pas chose possible. Heureux temps 1 jours si beaux, si purs, qu'êtes-vous devenus? Vous reverrons-nous encore? — Deux banquets nous furent offerts , l'un par la garde nationale, chez un restaurateur, l'autre par le 73e, dans les salons et sous la présidence du préfet, M. Sébire. Dans ces deux fêtes régna le plus heureux abandon , l'a plus franche cordialité. Le hasard avait fait rencontrer là, après vingt ans de séparation, deux compatriotes, deux camarades de collège, l'un représentant du peuple et, la veille encore, commissaire du département de Loiret-Cher; l'autre professeur dans un lycée de Paris, tous deux chefs de bataillon dans la milice civique, et comme tels placés côte à côte, sans autre préméditation. Leur reconnaissance avait été un vrai transport, et leur bonheur s'était communiqué à toute l'assistance. Les toasts s'en ressentirent, la conversation en fut empreinte. Bref, l'ivresse fut générale et prolongée; je dis prolongée, car le lendemain 3 mai, jour de notre départ, le conseil municipal de Blois, réuni par une convocation spéciale de M. Leroy, alors maire de la ville, aujourd'hui préfet du département, prit une délibération dont voici l'extrait, qui m'a été expédié sur parchemin et que je conserve religieusement parmi mes plus précieuses archives :
Extrait de la délibération du conseil municipal de la ville de Blois du 3 mai 1848.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE BLOIS ,
Considérant que les citoyens de la 11e légion de la garde nationale de Paris dont les nomi sont indiqués ci après (1) ont été les hôtes empressés et bienveillants de nos braves et chers frères du 73e de ligne en garnison à Blois , envoyés en détachement pour la grande fête du 20 avril dernier;
Considérant que ces enfants de Paris, reçus parmi nous avec effusion et bonheur, ont demandé à être considérés comme nos concitoyens; que cette demande est un témoignage d'estime et de fraternité dont nous sommes fiers et heureux : ARRÊTE A L'UNANIMITE: Les citoyens THEIL (Jean-François-Napoléon), 1er chef de bataillon, 2e bataillon , 11 e légion, rue d'Enfer, n° 14,... et autres, sont déclarés citoyens de Blois Ils seront inscrits en tête des tables de la population de la cité. Ils seront éligibles au conseil municipal en qualité de membres honoraires du conseil. Une correspondance suivie entre eux et ceux de Blois entretiendra les sentiments d'intérêt et de fraternité entre les citoyens de Blois et leurs concitoyens d'adoption.
Copie des présentes sera adressée à chacun d'eux et restera affichée dans la salle des séances du conseil.
Fait et arrêté à Blois, les jour et an que dessus. I.a minule est signée : DARNEAUX-BERRUER, DUPOU-GENTIL, FLOCEAU, GIRAUD, LANGE, PEAK, PORCBEK-GUIBERT, CORMIER. Dr DUFAT et LEROT. Le président de la commission municipale : LEROY.
Qui nous a valu, messieurs,ce diplôme de bourgeoisie blaisoise? Seraient-ce des discours incendiaires et des toasts couleur de sang? Il y a peu d'apparence. Notre titre à cet honneur fut sans doute la modération de notre langage parfaitement en harmonie avec les moeurs
(1) voici ces noms : Bartbélemier, Dusomraerard. Lhuilier, Lhéridean, capitaines ; Fèvre, Jollnnd , lieutenants ; Lalaisse , serpent ; Fume , Marescq , gardes.
- 13 -
paisibles de la cité; à moins que nous ne le devions à une autre conformité, hélas! plus passagère, avec le génie constant de nos hôtes, je veux dire à quelques saillies heureuses, inspirées parla gaieté générale ou dues à l'influence du lieu, et qui, le soir autour de la vaste table où fumait le café, moins bouillant que notre verve, faisait dire à mon ami Ducoux, héros principal de ce tournoi d'esprit: « Messieurs, nous sommes trop aimables, embrassons-nous et que cela finisse!» Brave Ducoux! de ton temps, j'étais l'ami et le convive du préfet de police, je n'étais pas pensionnaire de la conciergerie !
15 mai
C'est moi, messieurs , le croiriez-vous, qui al arrêté le citoyen Raspail, moi qui l'ai écroué au Petit-Luxembourg. Quand je dis arrêté, entendons-nous; je n'ai jamais de moi-même arrêté personne, et je m'y sens à présent moins disposé que jamais. Voici le fait. Après une chaude journée pleine de fatigues et d'alarmes , le 2e bataillon était venu de la rue de Tournon s'échelonner sur la place Saint-Michel et dans la rue. des Francs-Bourgeois. On sait que c'est dans la maison n° 5 de cette rue que Raspail vint le soir chercher un refuge chez son fils; on vint me dire qu'il était là et m'engager à l'arrêter. Je n'eus garde ; sans mandat, sans réquisition, je n'avais pas ce droit; j'ignorais d'ailleurs les détails de l'attentat et la part que Raspail y avait-pu prendre. Je fis seulement cerner à petit bruit et observer la maison. Mais bientôt M. Magin, qui avait appris aux Tuileries la retraite de Raspail et était allé immédiatement demander à M. Marie un ordre d'arrestation, arriva avec le lieutenant-colonel Pascal, et, requis en bonne forme de prêter ma coopération , j'obéis. Il me reste de ce jour-là trois bons souvenirs : le premier, c'est ce refus d'arrêter d'office et par zèle; le second , c'est qu'au moment de partir pour la prison, j'accordai : 1° à Raspail le père, qui n'avait pris qu'un bouillon le matin et qui redoutait la cuisine, pourtant fort renommée alors, du Petit-Luxembourg, la permission de prendre quelque nourriture chez son fils: permission qui lui fut aussitôt retirée par une volonté supérieure; 2° à Raspail le fils, l'amputé, qui ne figurait point sur le mandai d'arrêt, la faveur, sollicitée par lui, d'accompagner son père en prison. Le troisième enfin, c'est que sur ma prière, transmise rapidement sur toute la ligne par les soins du capitaine Brier, et accueillie partout avec une intelligence de coeur qui honore infiniment la 11° légion, le fiacre qui, outre les trois prisonniers, contenait encore M. Magin et moi, put cheminer au pas, de la Rue des Francs-Bourgeois au Petit-Luxembourg,-à'travers une double haie de gardes nationaux, sans qu'un cri, sans qu'un mot injurieux vint blesser l'oreille de ceux sur qui s'appesantissait la main de la justice. Partout un religieux silence témoigna de ce respect profond qui est dû à la personne sacrée d'un prisonnier. Je rappelle ces faits, moins pour en glorifier la 11° légion que pour la venger de quelques regrettables paroles prononcées devant la Cour de Bourges par celui-là même qui aurait dû moins que personne perdre la mémoire de nos bons procédés.
A ces trois souvenirs, j'en puis ajouter un quatrième non moins honorable pour la 11" légion. Quand, dans l'après-midi, nous vîmes défiler, rue de Seine, un bataillon de garde nationale au centre duquel brillait, au bout d'un fusil, l'épée arrachée au général Courtais, la vue de cette épée fit naître dans toutes les âmes un sentiment pénible. On ne put s'empêcher de penser que le général ainsi désarmé et dégradé était un vieillard à cheveux blancs. Même en le croyant coupable, on déplorait cette violence.

Le député Raspail emprisonné en 1849 (lithographie).
Journée» de juin.
Nous voici arrivés à une date néfaste, aux journées de juin. Ma conduite dans ces journées funestes n'est point assez connue. C'est ma faute. Chargé, comme commandant en premier, de faire un rapport général sur la part prise par le 2e bataillon à la défense de l'ordre, je m'attachai uniquement à faire valoir les services de mes camarades, laissant à mes supérieurs le soin de parler de moi. Ils l'oublièrent, ou plutôt, car je ne puis douter de leur bon vouloir, ils pensèrent m'êlre agréables en imitant mon silence; mon colonel se rappela sans doute, qu'à la prière qu'il m'avait adressée de lui signaler les hommes à décorer, j'avais répondu d'abord par la lettre que voici :
Mon cher colonel,
Après avoir lu et comparé les rapports de mes capitaines, recueilli l'opinion de chaque compagnie et consulté mes propres souvenirs , j'ai acquis la certitude que le deuxième bataillon , dont j'ai l'honneur d'être le chef, sut partout et toujours, pendant les funestes jour-
— 14 —
nées de juin , faire bravement son devoir. Placé sur la lisière même du terrain occupé par l'insurrection , il en a arrêté les progrés par son attitude ferme, tantôt défensive, tantôt aggressive. Mais je déclare n'avoir rien trouvé soit dans les faits qui m'ont été signalés, soit dans ceux dont j'ai été témoin , qui dépassât les bornes du devoir tel que nous l'entendons. C'est vous dire, mon colonel, que personne d'entre nous ne croit avoir mérité la décoration ; mais si je n'ai point de héros à vous présenter, j'ai, mon colonel, bien des positions dignes d'intérêt à vous signaler. J'ai vu bien des existences précieuses tranchées , bien des familles plongées du même coup dans le deuil et dans la misère! Permettez-moi, mon colonel, d'appeler sur ces nobles infortunes toute la sollicitude de la République, et de ne voir, dans l'affreuse guerre civile d'où nous sortons, que les victimes qu'elle a faites : elles sont nombreuses.
Agréez, mon colonel, etc.
Quoi qu'il en soit, la commission d'enquête, en provoquant ma déposition et celles de mes collègues, a réparé en partie cet oubli. Malheureusement le travail de cette commission ne brille point par l'exactitude, et j'ai dû, à l'époque où le général Cavaignac eut à se défendre à la tribune contre d'indignes accusations, envoyer au président de l'Assemblée nationale ma déposition rétablie. La voici avec la lettre d'envoi qui l'accompagnait. Cette pièce, messieurs, est un document précieux pour l'histoire.
Paris, 23 novembre 1848. Monsieur le président,
Un grave débat va s'ouvrir devant l'assemblée nationale. Les faits consignés dans le Recueil des pièces publiées par la commission d'enquête seront sans doute invoqués et commentés. Il importe par conséquent que les dépositions qui peuvent jeter quelque jour sur le rôle et l'attitude des principaux personnages intéressés dans le débat soient connues autrement que par une analyse nécessairement très-sommaire, très-décousue, et renfermant inévitablement de fréquentes erreurs de chiffres, de dates et de noms propres. Je croirais, pour ma part, manquer à mon devoir d'honnête homme et de citoyen, si, dans des circonstances aussi critiques , je souffrais que de mon témoignage , inexactement et incomplètement reproduit, on pût faire un argument pour ou contre tel ou tel personnage politique. Il faut que la lumière se fasse ; mais il faut que cette lumière soit l'éclat de la vérité, non une lueur factice et trompeuse. En conséquence, je vous envoie sous ce pli, monsieur le président, le récit détaillé de tous les faits qui sont à ma connaissance personnelle, et dont j'affirme sur l'honneur la parfaite exactitude.
Agréez, etc.
Déposition du citoyen THEIL , commandant de la 11e légion.
Le jeudi 22 juin, j'ai vu, le soir, sur la place du Panthéon , environ 4,000 personnes fort animées qui conspiraient ouvertement et annonçaient pour le lendemain matin, à six heures, une attaque générale. Le copiste des notes de la commission d'enquête me fait dire 40,000. C'est un zéro de plus. On sait quel parti la Presse tire de ce zéro, tout incroyable qu'il est.
Le vendredi 23, à sept heures du matin , un rassemblement considérable stationnait sur celte même place du Panthéon, rendez-vous de l'insurrection. Voyant une bande de gamins, détachée de la foule, poursuivre à coups de pierres un citoyen inoffensif, le peintre Savignac, l'indignation me saisit, et ne trouvant au corps de garde de la place Saint-Michel que six ou sept mobiles, je résolus d'aller me plaindre à la commission éxécutive de cette absence totale de dispositions militaires dans un quartier notoirement menacé. Chemin faisant, je rencontrai trois de mes collègues, les chefs de bataillon Cottu, Renaud et Masson (le copiste a lu Garantier) ; je les priai de se joindre à moi: ils me suivirent. Sur l'escalier nous trouvâmes M. Recurt qui redescendait, n'ayant trouvé personne à qui parler, et qui était venu , nous dit il, pour le même objet que nous. Il partit. Quant à nous, ayant appris que M. Arago était au Luxembourg, mais couché, nous insistâmes très-énergiquement pour le voir. Il nous reçut. Son lit était couvert de journaux et de papiers. Je lui exposai ce que je venais de voir; je lui peignis la situation du quartier. Je qualifiai sévèrement cette incurie de l'autorité; je prononçai les mots de connivence, de trahison, qui étaient, dis-je, dans toutes les bouches, et commençaient à venir sur les lèvres des gardes nationaux. Je représentai la nécéssité de faire taire enfin ces bruits, sans doute calomnieux, par une conduite nette et sans équivoque. Pour premier gage de dévouement à la cause de l'ordre, nous demandâmes l'autorisation de faire sur-le-champ battre le rappel et au besoin la générale. L'attitude de M. Arago avait été jusque la celle de l'étonnement ; il ne paraissait pas croire à la réalité ou du moins à la gravité du danger. Nous l'avions trouvé couché lisant très-paisiblement ses journaux ou ses dépêches. Tout cela ne se peut expliquer que par une parfaite sécurité. Notre demande l'embarrassa visiblement. II paraissait craindre de se compromettre en accordant l'autorisation demandée ; mais nos instances étaient vives, il accorda verbalement; nous voulions, nous, l'autorisation écrite, et pour cause. Écrite, il ne pouvait : il n'y avait là ni plume, ni encre, ni papier, et, bien que le colonel Anfrye, qui nous avait accompagnés , espérât trouver aisément tout ce
— 15 —
Matériel, M. Arago éluda. Il préféra, sur mon invitation, se lever et venir s'assurer par ses yeux de l'état des choses. Nous sortîmes alors et allâmes faire battre le rappel.— Une demi heure après, M. Arago était levé et en tournée. La commission d'enquête me fait dire que M. Arago déploya le lendemain une grande énergie. Lisez : Ce jour-là même, el dès le matin. J'ai eu l'honneur de le déterminer à marcher à notre tête contre l'émeute; je l'ai conduit.au milieu des acclamalions de la foule, à la barricade de la rue Soufflot, à celle de la rue des Mathurins-Saint-Jacques; j'étais près de lui quand il parlementait avec les insurgés, j'ai été avec lui le soir chercher l'artillerie du Luxembourg; je l'ai entendu, la voix pleine d'émotion et les yeux mouillés de larmes, ordonner le feu, en recommandant, au nom du ciel, de tirer au pied de la barricade, et je dois dire que, dans toutes ces circonstances, il a été admirable de sang-froid , de patience , de fermeté , de compassion et enfin de désespoir. Sa vie a élé plusieurs fois en danger, notamment à la barricade de la rue Soufflot, où un enfant dirigea conlre lui un pistolet qu'une main vigoureuse détourna heureusement.
Le rappel n'ayant rien ou presque rien produit la première fois, il fallait le faire battre une seconde. Mais notre colonel ,M. Quinet, craignait d'engager sa responsabilité. Il voulut un ordre écrit. Je nie rendis avec lui au Luxembourg, où, celle fois, la commission executive etail réunie au grand complet. Tous les ministres étaient présents et plusieurs autres personnes, entre autres M. Cl. Thomas. Le colonel demanda l'ordre écrit, et attendit la réponse. Plusieurs groupes chuchotaient mystérieusement aux angles de la salle- Plusieurs personnages, rangés autour de la longue table (et de ce nombre le général Cavaignac, place en face de moi,, écrivaient, absorbés dans leur travail ; moi, je m'entretenais avec M. Lamartine , qui se tenait debout, les bras croisés sur la poitrine, entre les deux fenêtres, tournant le dos à la console. Je lui répétai avec feu et tout haut ce que j'avais dit le matin à M. Arago; je demandai qu'on déployât enfin l'activité et l'énergie que réclamaient les circonstances, déclarant que, dans le cas contraire, la garde nationale saurait ce qu'elle aurait à faire. Il faut aujourd'hui, ajoutai-je, du canon et de la mitraille. A ces mots le général Cavaignac leva les yeux, et je crus remarquer un mouvement de tête approbatif; M. Lamartine, à qui j'ai eu le bonheur d'être utile le 25 février, dans un moment fort critique, à l'hôtel de ville, m'avait reconnu. Il me répondit : Oui, il faut en finir; je ne demande pas autre chose et aujourd'hui j'irai, soyez-en sûr, combattre, et, s'il le faut, mourir à vos côtés.
Cependant M. Quinet attendait toujours son ordre. Comme il insistait au milieu de cette réunion distraite où personne ne l'écoutait, M. Garnier-Pagés, personnellement interpellé au moment où il se dirigeait vers la porte, et visiblement importuné de ces instances, fit un geste très-prononcé de mauvaise humeur, el dit à M. Barthélémy Saint-Hilaire : « Saint-Hilaire, monsieur veut absolument un ordre écrit pour battre le rappel ; préparez-le. » L'ordre préparé fut signé, je ne sais par qui (par M. Marie, si je ne me trompe), et nous partîmes. A dix heures et demie, un ordre signé Clément Thomas enjoignit au colonel de porter mille hommes de la légion à l'Assemblée nationale. Cel ordre, qui se rattachait sans doute à un plan général, me parut étrange. Quitter le quartier au moment où de toutes parts on construisait des barricades me paraissait une haute imprudence, et, pour mon compte, je ne l'aurai» exécuté pour rien au monde. Le colonel, esclave de la consigne , réunit le plus de gardes nationaux qu'il put et partit-, moi, j'avais couru au Luxembourg pour signaler le péril de la situation. Je rencontrai, dans la grande cour du Luxembourg, M. Arago, qui se rendait à l'Assemblée. Instruit de ce qui se passait: Nom de D...! s'écria-t-il , en frappant du pied la terre , qui peut donner de pareils ordres? Courez, arrêtez-les ! » Je courus el trouvai la colonne arrêtée sur la place Saint-Sulpice , plusieurs des commandants ne voulant pas, dans un moment si critique, abandonner le quartier. Le colonel, avant de consentir au mouvement rétrograde ordonné par M. Arago, voulut en référer à la commission. Nous le suivîmes plusieurs au Luxembourg. M. Garnier-Pagès y était seul alors. Consulté , il repondit qu'il fallait exécuter l'ordre et se rendre à l'Assemblée. Le commandant Rousseau lui objecta que de tous les côtes on élevait des barricades : « Les barricades! les barricades! s'écria-t-il, que cela ne vous inquiète pas. Les barricades, on les défera comme on les aura faites! » — Monsieur, répliqua le commandant Rousseau, vous serez responsable des événements. »— «Oui, oui, soyez tranquille; d'ailleurs je reçois à l'instant la nouvelle que le général Cavaignac vient d'être investi du commandement supérieur de toutes les forces militaires ; il a son plan . qui est de masser toutes les troupes autour de l'Assemblée pour les faire de là rayonner partout où besoin sera. Il ne veut point les disséminer, et il a raison.
Cette réponse de M. Garnier-Pagès rappelle naturellement celle que le même jour M. Pagnerre fit au directeur de l'École normale, venant offrir au gouvernement le concours des élèves: Retournez, messieurs, retournez à votre école, el livrez-vous paisiblement à vos travaux. Ce ne sera rien. »
Le colloque en était là avec M. Garnier-Pagès, lorsque arriva un officier d'état-major, M. Delmas, aujourd'hui aide de camp du général Lamoriciére, qui cherchait le colonel Anfrye, et, le trouvant avec nous, lui transmit l'ordre d'envoyer sur-le-champ deux bataillons à l'Assemblée. Le colonel demeurait immobile, regardant M. Pages. Jicessé d'avoir la réponse, l'officier lui dit: Songez, colonel, qu'il y va pour vous du conseil de guerre. » Alors M. Garnier-Pagès, qu'interrogeait toujours le, regard inquiet du colonel , lui dit : » Enrayez deux bataillons de mobiles. » Celui-ci s'inclina cl partit. Pressé de nouveau par nos instances, M. Garnier-I'agéa nous dit alors : Eh bien! restez ;il nous autorisa même, sans trop de façon , à faire battre la
— 16 —
générale. Le commandant Rousseau lui demandant alors un peloton de troupes dé ligné, afin de ne pas exposer aux premiers rangs, dans l'attaque des barricades, des gardes nationaux pour la plupart pères de famille, M. Garnier-Pagès refusa, disant qu'il ne pouvait dégarnir le Luxembourg : » Ce ne sont que des pierres, dit il , mais si ces pierres étaient au pouvoir de l'insurrection, ce serait d'un pitoyable effet. » Nous pensâmes, nous, qu'il y avait au Luxembourg mieux que des pierres à garder, puisque M. Garnier-Pagès y était, et nous n'insistâmes pas.
Dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit et demi, le général Cavaignac, à cheval, et suivi d'un état-major peu nombreux, vint au carrefour de l'École de médecine où était établi mon bataillon , et demanda le général Damesme dont le quartier général était au musée do Cluny. Celui-ci se trouvait en ce moment avec nous chez le restaurateur Janodet, rue de la Harpe, où il prenait quelque nourriture. Il sortit; le général Cavaignac descendit de cheval et tous deux s'assirent sur un banc devant la boutique de M. Champenois, marchand de vin, au coin de la rue de l'Ecole-de-mèdecine. Les officiers supérieurs de la 11e légion qui se trou - raient présents firent le demi-cercle devant eux. Le général Cavaignac s'informa de l'état du quartier, de la position et du nombre des barricades, des forces de l'insurrection el de celles dont nous disposions. Chacun dit ce qu'il savait, et la fusillade qui continuait toujours à l'extrémité de la rue des Mathurins, dans la rue du Foin et dans la rue des Noyers, en disait encore davantage. Le commandant Rousseau lui parla de la barricade de larue des Sept-Voies, des insurgés retranchés derrière cette barricade, derrière celle de la place Saint-Elienne-duMont et dans l'église. «Mon cher enfant, dit le général Cavaignac au général Damesme, au petit jour je vous enverrai des forces et de l'artillerie. Nous délogerons à tout prix ces gaillards-là, dussions-nous faire sauter avec des pétards et la bibliothèque et l'église. Peut-être viendrai-je moi-même ; cela dépend de l'état des autres quartiers que jt vais connaître en les parcourant. » Cela dit. il serra la main pour la dernière fois à l'infortuné général et partit, enveloppé de son caban, pour continuer sa ronde rapide et silencieuse.
J'ai déposé encore d'un fait grave qui, de l'aveu de M. Odilon Barrot, à qui je l'ai raconlé, s'est reproduit sur plusieurs points, et qui prouve jusqu'à l'évidence qu'il y avait ces jours-là des olficiers d'état-major travaillant au succès de l'émeute. De tout ce que nous avons vu pendant ces fatales journées, il est résulté pour nous la conviclion qu'une vaste trahison existait dans les régions supérieures, je ne saurais dire à quels degrés, et que des agents nombreux faisaient, sous l'uniforme, les affaires de l'insurrection.
Voici le fait signalé par moi : le samedi, vers deux heures ; en cherchant le colonel Anfrye dans le Luxembourg, je m'aperçus qu'une barricade se construisait à l'extrémilé de la rue Royer-Collard el que les insurgés paraissaient vouloir cerner celte partie du jardin où leurs prisonniers étaient gardés dans une salle attenante à l'Ecole des mines. J'avais déterminé le colonel à faire monter à cheval un escadron de dragons stationné dans le Luxembourg, afin d'aller empêcher celte barricade. Un officier d'état-major qui arrivait nous assura qu'il serait impossible à la cavalerie de passer parla place Saint-Michel, qui était, disait-il, hérissée de barricades et au pouvoir des insurgés. J'en témoignai mon étonnement, car mon bataillon occupait celle place; mais comme j'arrivais de l'Assemblée nationale où j'étais allé seul demander du renfort, et que j'étais absent depuis une heure et demie, je le crus sur parole. Le fait était complètement faux. La place élait libre et toujours occupée par mon monde. Le 23 novembre I848.
THELL.
Ce document, remis par moi à M. Marie, passa des mains de M. Marie dans celles de M. Marrast, puis, je crois, dans celles du général Cavaignac, et enfin dans celles de M. Bauchart, rapporteur de la commission d'enquête, à qui il appartenait d'en contrôler l'exactitude et d'en faire, au besoin , lecture à l'Assemblée. Il ne fut pas lu. Les lecteurs intelligents comprendront pourquoi, et trouveront, sans doute, que le général accusé fut bien généreux.
Quant à mon rôle personnel, vous devez, messieurs, commencer à le comprendre. Peut être le 23 juin ai-je donné quelque preuve de courage civil, peut-être n'ai-je pas manqué non plus de tout courage militaire. Vous en seriez convaincus si, attentifs aux débats des conseils de guerre, vous aviez appris, par maintes révélations, les périls que j'ai affrontés de ma personne soit en parlementant, soit en combattant aux barricades, notamment à celle de la petite rue de Cluny, où je n'échappai que par une chute providentielle aux coups de fusil tirés sur moi à bout portant. Je pourrais vous parler des balles qui sifflèrent autour de moi dans le jardin du Luxembourg, de celle qui m'effleura le crâne dans la rue Racine, lorsque j'essayai, en ces deux endroits, d'arracher à la fureur des gardes mobiles de malheureux prisonniers dont ils avaient décidé la mort; je pourrais vous parler de la part que j'ai prise, le dimanche 25, sur la prière et aux côtés de l'infortuné général de Bréa, à cette funeste expédition de la barrière de Fontainebleau, où je ne fus séparé du même martyre que par l'intervalle de deux secondes el la longueur d'un demi pied. Mais à quoi bon insister sur ces particularités? je ne cherche point ici la réputation
- 17 —
d'homme brave : aujourd'hui tout le monde est brave; je revendique le titre d'homme d'ordre, que j'ai conquis, ces jours-là, par les périls de la rue, comme je crois avoir conquis , sur un autre champ de bataille et par des dangers d'un autre genre , le litre qui ne m'est pas moins cher, d'homme de progrès.
19 juin.— Commandant Masson. — Commandant Laigneau.
Je voudrais détourner mes regards de ces souvenirs de juin : mais un pieux devoir m'arrête. Après les horreurs des combats viennent les tristes scènes des funérailles, et nous touchons au 29 de ce mois, où eurent lieu en même temps les obsèques de deux chefs de bataillon, l'un du 73e de ligne, l'autre de la 11e légion, morts le même jour, presque à la même heure, presque aux mêmes barricades. La 11e légion, obligée de rendre à la fois les derniers devoirs à l'un île ses commandants, M. Masson, enterré au Père Lachaise, et à un de ses hôtes et frères d'armes, le commandant Laigneau, enterré à Montmartre, se partagea cette double et triste tâche. Un fort détachement de la 11e légion, sous les ordres du commandant Cottu, conduisit le commandant du 73e à sa dernière demeure. Je fus chargé des adieux. Voici mes paroles ; je les extrais de la Démocratie pacifique , où elles furent insérées.
Citoyens et soldats.
Je viens devant celte tombe acquitter, au nom de la 11e légion tout entière , la dette de la fraternité, et en mon nom personnel, au nom de plusieurs de mes camarades, la dette de l'amitié. Le brave officier sur qui va se fermer cette tombe est celui-là même avec qui fut scellée, il y a quelques mois, à Paris d'abord , et plus tard à Blois, entre le régiment et la légion, cette union étroite, indissoluble , de la garde nationale et de l'armée, qui a fait, dans les fatales journées que nous venons de traverser, le salut de Paris et de la France.
Hélas ! nous ne pensions point alors que cette alliance fraternelle dût être si tôt scellée une troisième fois par le sang. Mais la Providence a ses desseins. Remercions- la, malgré notre tristesse , d'avoir permis que ceux qui s'étaient déclarés frères se trouvassent réunis, au moment du danger, pour l'affronter ensemble et mourir côte à côte. Remercions la mort ellemême, qui semble, en nous frappant, nous avoir aussi traités en frères. La n" légion et le 73e ont été cruellement éprouvés; de part et d'autre, des victimes d'élite, des victimes nombreuses sont tombées, et nous avons été égaux par le tribut, comme nous l'étions par le dévouement au pays. En effet, messieurs , au moment où je parle , une autre tombe est ouverte; d'autres larmes coulent, dont une part s'adresse à la victime qui est sous nos yeux , comme celles que nous versons ici s'adressent en partie à l'autre martyr qui reçoit ailleurs no» derniers adieux.
Mais ce sont là des douleurs de famille ; sachons les maîtriser ou plutôt confondre notre deuil dans le deuil public, dans la douleur immense qui déchire en ce moment les généreuses entrailles de notre mère commune, la patrie. obligée de pleurer à la fois et sur ses fils égarés, et sur ses enfants fidèles. En présence de tant de désastres. je ne puis que former un voeu : Puisse cette vaste hécatombe, puissent ces milliers de victimes humaines, puissent ces larmes et ce sang qui coulent à flots satisfaire enfin et fléchir le génie du mal et rendre à notre belle patrie le calme et la sérénité dont elle a tant besoin ! Puisse celte sanglante et terrible épreuve être la dernière que la fortune de la France ait à traverser !
Commandant Laigneau, notre ami, notre frère, nous jurons ici, nous jurons tous, non pas de le venger (c'est une vengeance trop amère que celle qui s'exerce sur des frères égarés et môme coupables), mais d'imiter ton noble exemple ! Oui, si le fléau de la guerre civile doit désoler encore noire pays, on nous verra tous , citoyens et soldats, courir avec le même dévouement, la môme abnégation, aux barricades, et présenter nos poitrines aux balles fratricides. Oubliant nos enfants et nos femmes, ou plutôt le coeur plein de ces chères images, nous irons sans hésiter au combat. Car la cause que nous défendons est celle de l'ordre et de la liberté ; celle de la famille, de la propriété, de la civilisation. Comme toi, nous saurons mourir ; car nous mourrons avec la certitude consolante de léguer à nos fils une pairie telle que nos coeurs la désirent, avec la certitude de conserver à la France, au prix de notre sang, son nom, sa gloire , sa primauté parmi les nations. Commandant Laigneau, lu as payé ta dette à la patrie ; comme toi, nous sommes prêts à payer la nôtre. Adieu ; ton souvenir vivra dans notre mémoire entouré d'un religieux respect; car lu es mort en bon citoyen et en bon soldat. Adieu , et vive la France! vive la République !

Horace Vernet — The French revolution of 1848 Barricade dans la rue de Soufflot, à Paris, le 25 juin 1848 (vers 1848-1849).
FÊTES
Passons enfin à d'autres images. Vous savez , messieurs , qu'un grand nombre de villes de France, accourues au premier signal de la détresse de Paris, eurent leur part dans la lutte cl dans les douleurs de juin. De cette communauté de dévouement et de sacrifices naquit une fraternité plus étroite entre la province cl la capitale. Chaque ar-
— 18 —
rondissement eut dès lors ses hôtes, ses frères d'armes particuliers, et il s'établit, malgré les distances, une foule de relations aussi douces qu'utiles.
Parmi les hôtes de prédilection du 11e arrondissement figurent en première ligne les Calaisiens. Aussi, vers la fin d'octobre, quand les plaies communes furent moins saignantes, la 11e légion voulut-elle faire une visite à Calais et porter en présent à la garde nationale de cette cité ce que des frères d'armes peuvent s'offrir de plus cher et de plus significatif, un drapeau. Un projet d'excursion à Londres se rattachait à ce voyage. Bien que je n'aie guère de loisirs et d'argent à semer sur les grandes routes, je dus me rendre au voeu de mon bataillon et accepter l'honneur d'être , en cette circonstance , son guide et son interprète.
Voici le compte rendu de cette double expédition, inséré dans le Bien public du 30 octobre. L'article est de moi ; il vous donnera, avec les détails de la fête, une idée et de mon rôle et de la manière dont j'apprécie celui des autres.
Monsieur le rédacteur,
FETE DE CALAIS.
Paris, 27 octobre 1848.
J'arrive de Calais , le coeur tout ému de la cordiale, gracieuse et large hospitalité que nous y avons reçue, et de la fête magique qui nous a été donnée. Je ne puis résister au plaisir de vous raconter tout cela. De tels récits sont la bonne nouvelle de notre époque. Ils reposent l'esprit et le coeur du spectacle affligeant des conflits de la tribune et des luttes acharnées de la presse. Ils dissipent les terreurs dont on a peine à se défendre à l'aspect des nuages qui s'ammoncèlent à l'horizon politique ; en un mol, ils rendent à toutes les âmes la confiance et l'espoir.
Samedi soir, de six heures à sept heures et demie, arrivèrent, par trois convois successifs, au débarcadère de Saint-Pierre-lès-Calais , 1,600 Parisiens, dont 1,200 environ appartenant à il" légion, le reste aux autres légions et aux divers corps de la garnison parisienne. Tous étaient en uniforme et en armes. Ils allaient offrir à la garde nationale de Calais, si prompte à voler au secours de Paris menacé, un gage de leur affectueuse reconnaissance, un drapeau richement brodé aux armes de Calais et de Paris. Ils furent reçus, au sortir du débarcadère , par la garde nationale de Calais réunie en armes dans la plaine. Un immense cri s'éleva alors vers le ciel : Vivent nos frères de Paris! vivent nos frères de Calais! Le cortège se forme et s'ébranle, et les deux milices réunies, sapeurs , tambours et musique en tête, s'avancent, à la lueur des torches, au milieu des vivais et des cris de joie de toules les populations du faubourg, jusqu'aux portes de Calais.
Le lendemain, de bonne heure, la ville était sillonnée en tous sens par de longues caravanes qui se rendaient, sur le port et sur la jetée, impatientes de voir la mer. spectacle nouveau pour la plupart des Parisiens, généralement peu touristes. Dire l'effet produit par l'aspect de celle immense plaine humide, calme et unie comme une glace le premier jour, et le lendemain soulevée par un vent violent, furieuse, écumanle, comme si elle-même se fui complaisamment prêtée à nos plaisirs , je ne l'entreprendrai pas. Ceux qui ont vu la mer s'en rendront compte aisément, et ceux qui ne l'ont point vue ne peuvent s'en faire une idée : qu'ils aillent à Calais. Je renonce également à énumérer les douzaines d'huîtres ouvertes chaque matin par les écaillères du port el consommées en un clin d'oeil devant leurs échoppes. Cette prodigieuse consommation ne se peut expliquer que par la nécessité où les Calaisiens avaient mis leurs hôtes de s'ouvrir de bonne heure un insatiable appétit.
Vers dix heures devait avoir lieu l'entrée officielle. Dès neuf heures, toute là députation parisienne était réunie en armes à l'entrée de la ville, où la garde nationale de Calais, accompagnée de toutes les troupes de la garnison , gendarmerie à cheval, infanterie de ligne , brigade de douane, vint les recevoir. M.Ernest Lebeau, maire de Calais, et M. Magin, adjoint au maire du arrondissement, échangèrent à cette occasion , au nom de Calais et de Paris, d'éloquentes paroles , inspirées par le sentiment profond de la fraternité républicaine el empreintes du plus pur patriotisme.
Après ces discours, accueillis de part et d'autre avec le plus vif enthousiasme, le double cortège se mit en marche et fit son entrée en ville, musique en tète et au son des airs nationaux. Toutes les rues qu'il devait parcourir étaient pavoisées de drapeaux tricolores, jonchées de fleurs , tapissées de feuillage ; ici de vertes guirlandes, là des rubans aux couleurs nationales, ailleurs de magnifiques tentures se balançaient au-dessus de la foule; des poteaux plantés de distance en distance de chaque côté de la rue, revêtus de guirlandes el ornés de divers écussons, supportaient ce toit flottant, cette longue série de berceaux, avenues parfumées conduisant à des arcs de triomphe. Les bouquets , les couronnes de fleurs, tombaient de toutes les fenêtres sur les gardes nationaux; les dames agitaient leur mouchoir ; toute la population battait des mains. L'air relentissait alternativement des cris mille fois répétés de Vivent les Parisiens! Ville la garde nationale de Paris! Vive Calais! Virent les Calaisiens! Vive la ligne! Puis venait une acclamation universelle, un cri d'ensemble : Vive la République 1 qui roulait d'échos en échos et s'élevait vers le ciel tantôt comme un hymne d'actions de grâces, tantôt comme une solennelle, et fervente prière du peuple.
- 19 -
Joignez à tous ces bruits d'allégresse le son des cloches en brante , la Voix tonnante de l'artillerie du Kisban , et vous aurez une idée de la scène par laquelle s'ouvrait la fête...
A une heure , on se remit en marche pour parcourir les rues de la ville qui n'avaient pas encore été visitées. Pendant tout ce trajet, les mêmes scènes d'allégresse se renouvelèrent. L'enthousiasme fut au comble lorsque, à la hauteur de la rue de Croy, le clergé vint prendre place dans les rangs, en avant des autorités civiles et militaires.
De retour sur la place d'Armes, le cortège entoura une seconde fois l'estrade sur laquelle un autel avait été dressé pour la bénédiction du drapeau. On procéda à cette imposante cérémonie. Le lieutenant Blosse , vénérable vieillard, que sa longue barbe, blanche comme la neige, el le drapeau qu'il portait, désignaient au respect de la foule , s'avança sur les degrés de l'estrade et présenta l'étendard aux bénédictions de l'Eglise. Plusieurs discours furent prononcés. M. Buchère, maire du 1 ic arrondissement, exprima aux Calaisiens, dans une allocution pleine de dignité et d'effusion, la joie qu'il ressentait en confiant à leur patriotisme éprouvé , au nom de la 1e légion et de la République , ce drapeau destiné à cimenter l'union fraternelle de Paris et de Calais. Le maire de Calais répondit par quelques paroles chaleureuses, parfaitement appropriées à la circonstance , et vivement applaudies.
Après lui, M. Pred'homme , curé-doyen de Notre-Dame de Calais, suivi de son clerge, s'avança et lut, d'une voix pleine d'onction, un discours où se confondaient, par la plus heureuse alliance, les sentiments du chrétien et ceux du citoyen. Cette allocution paternelle produisit sur toute l'assistance une impression profonde. Après la bénédiction du drapeau par les mains de ce vénérable prêtre, le clergé entonna le Te Deum et le Domine salvam fac Rempublicam , au bruit des cloches, du carillon et des salves d'artillerie.
M. Guilhem, commandant en chef le détachement de la 1 1e légion, prit alors la parole, et remit entre les mains de M.Pierredon, commandant de la garde nationale de Calais, ce drapeau consacré par la religion. M. Pierredon, en le recevant, répondit au discours de M. Guilhem par quelques paroles empreintes d'une énergie toute militaire, et d'un dévouement sincère à la cause de la République, c'est-à-dire à la cause de l'ordre et de la liberté.
Puis vint le tour de M. le commandant Theil, de la 11e légion, qui, au milieu du plus religieux silence, prononça les vers suivants :
Amis, serrons-nous tous , heureux fils de la France , Autour de ce noble drapeau ! Gage de paix , symbole d'alliance , Il porte dans ses plis tout un monde nouveau.
Longtemps Il fut pour nous l'étendard de la guerre .
Emblème de sang et de feu ; Longtemps il rappela , pour l'effroi de la terre,
Des batailles l'horrible jeu.
Moins terrible aujourd'hui , jaloux d'une autre gloire ,
Il renonce au sanglant laurier ; Désormais , pour marquer sa paisible victoire ,
Il veut la palme et l'olivier.
Regardez : que lit-on sur l'augaste bannière? Un mot qui par Jésus fut an monde apporté , Un mot qui changera la face de la terre, Un mot divin : Fraternité i
Frères , des jours meilleurs, croyez-moi , vont éclore
Chacun de vous ne vient-il pas de voir Les ministres du Christ en saluer l'aurore. Le coeur rempli d'an saint espoir
C'est qu'un esprit nouveau s'est levé sur le monde ,
Esprit d'amour, de concorde et de paix;
Notre France en son sein réchauffe et le féconde ,
Germe heureux d'un sage progrès.
Voyez déjà, voyez cette vivo lumière Qui monte et brille à l'horizon plus pur, Et. près d'illuminer la terre tout entière. Déjà du ciel de France a coloré l'azur.
Pièce a pièce voyez tomber le monde antique,
lEt la fraternelle cité S'élever lentement du sol évangélique
Aux rayons de la liberté.
Salut, noble drapeau, doux gage d'espérance
Qu'avec transport reçoit la chrétienté Salut au nom de tous ! car le drapeau de France Est celui de l'humanité.
VIVE LA FRANCE ! VIVE LA RÉPUBLIQUE! Ces vers produisirent une vive impression parce qu'ils exprimaient parfaitement le carec -
- 20 -
tère fraternel et religieux de cette solennité. Ils durent aussi Une partie de leur effet à une' circonstance étrange , qui frappa la foule d'une sorte d'étonnement superstitieux. Au moment où fut prononcée la strophe qui commence par ces mots :
Voyez déjà, voyez cotte vive lumière, etc.,
le soleil, se dégageant, comme par enchantement, du voile nébuleux qui l'avait dérobé toute la matinée aux regards, inonda d'une lumière soudaine et l'estrade et l'orateur; un frisson électrique parcourut toute l'assemblée.
Une cérémonie touchante succéda à la bénédiction et à la réception du drapeau. Les autorités civiles, militaires et maritimes, suivies d'un nombreux cortège, se rendirent à l'Hôtel de-Ville pour assister à l'inauguration de la plaque scellée dans le mur du grand escalier el destinée à perpétuer la mémoire du citoyen Werner, ingénieur des ponts et chaussées, mort à Paris, le 27 juin 1848, en défendant l'ordre et la société.
Jamais scène plus attendrissante n'a succédé aux transports d'une plus vive allégresse. 11 faut lire dans le Journal de Calais les discours prononcés à cette occasion, et surtout la sublime lettre du père de la victime. De ces deux martyrs , on sait quel est le plus à plaindre ; on ne sait lequel on doit le plus admirer.
Le reste de l'après-midi fut consacré aux joies intimes du foyer et aux largesses de l'hospitalité calaisienne,
Le soir, il y eut bal et concert dans la salle de spectacle. La musique de Calais et celle de la 11e légion rivalisèrent, et ce n'est point un médiocre éloge de dire que cette fois, la province fut digne de Paris. Honneur à la musique de la garde nationale de Calais ! Honneur aussi à MM. Konlski, Forestier, Garimond,Boulcourt et Adam, qui, ce jour-là, se surpassèrent!
La deuxième journée de la fête, sans être aussi brillante, a été bien remplie. A sept heures , les paquebots de l'État, chargés de gardes nationaux , sortaient du port pour faire une excursion en rade et donner ainsi à messieurs de Paris un de ces plaisirs qui font époque dans l'existence d'un habitant de la capitale.
A midi, les gardes nationaux de Paris et de Calais , la troupe de ligne, la douane et la marine , entremêlés, confondus, entouraient des tables dressées sur la place et prenaient part à une fraternisation dont la vivacité, l'animation et la franche cordialité ne sortiront jamais de nos souvenirs. Le choeur des Girondins dominait le bruit.
Sur l'estrade élevée au milieu de la place, l'état-major réuni prenait part à cette manifestation toute fraternelle. Plusieurs toasts y ont été prononcés; voici ceux que nous avons pu recueillir :
Par M. le maire de Calais : A nos hôtes de Paris! Aux gardes nationaux de la 11" légion el à la République I
Par le commandant Guilhem : Aux dames de Calais!
Par le commandant Cottu : A la garde nationale de Calais !
Par le même : A l'hospitalité calaisienne!
Par le commandant Theil : A la fraternité des peuples 1
Par le même : A la mémoire des victimes de juin, aux citoyens morts pour la cause de l'ordre et de la liberté, et particulièrement au brave citoyen Masson, noire infortuné camarade!
Tous ces toasts , développés avec le genre d'éloquence qui convenait à chacun , furent accueillis avec transport.
Pour clore dignement cette fête toute poétique, le citoyen Manesson , lieutenant dans la 11e légion, chanta avec une verve et un entrain communicatifs, trois couplets composés par lui pour la circonstance.
A quatre heures, un concert a été donné sur l'estrade de la place d'Armes par les deux musiques réunies. Toute la population de Calais était accourue, avide d'entretenir son enthousiasme par les mâles accents de la musique militaire.
Le soir, un bal splendide réunissait, dans l'élégante salle de la Société philharmonique, tout ce que Calais renferme de jolies femmes , c'est-à-dire qu'il y avait foule. On a dansé jusqu'à l'aube.
Je voudrais, mon cher rédacteur, vous parler d'une visite faite au Courgain, quartier maritime de Calais , par le commandant Guilhem, suivi de quelques officiers de la il« légion; il y aurait de curieuses études à faire sur les moeurs de cette intéressante et pittoresque population.
Je voudrais surloul vous parler de ce fameux voyage à Londres qui donne lieu à tant do commentaires; mais l'espace me manque, et ici l'historien doit se souvenir qu'il n'est que journaliste. Je vous dirai seulement, sur ce dernier point, qu'aucune députation n'a été envoyée par la 11e légion aux hôtes de Claremont. Voici ce qui a pu donner lieu à celle fable : Quelques anciens serviteurs de la maison d'Orléans, désirant vivement revoir leurs anciens maîtres , et trouvant l'occasion bonne pour faire cette visite à peu de frais, ont emprunté des uniformes de gardes nationaux, se sont procuré des billets et sont partis avec nous, profitant de la réduction de prix qui nous était accordée sur les chemins de fer français et anglais. Respectons cet innocent stratagème de la reconnaissance privée, et laissons les ennemis de la République transformer un acte, hélas ! trop rare de piété domestique et de fidélité au malheur en une protestation contre la forme de gouvernement que la France s'est donnée.
Je termine en vous disant qu'à notre, départ, nous avons été accompagnés jusqu'à l'embarcadère , c'est-à-dire à une demi-lieue , par la garde nationale de Calais, musique en tête, et par toute la population. Cet immense cortège, marchant à la lueur ries torches, chantant les airs nationaux, salué sur son passage par mille cris d'enthousiasme, échangeant enfin de tendres adieux et poursuivi jusque dans les wagons par les vivais de ses hôtes, a laissé dans mon dans une impression que rien n'effacera. Je me souviendrai toute ma vie de l'hospitalité calaisienne.
Je m'abstiens, messieurs, de toute réflexion. A vous seuls appartient le droit de commentaire.
Puisque j'ai dû rappeler ici les souvenirs de Calais, permettez, messieurs, que je les complète , en joignant à ma poésie officielle quelques modestes couplets composés sur la jetée du port , sous l'inspiration du spectacle qui s'offrait à mes yeux. Voulant laisser à mon excellent hôte, M. Gageot, lieutenant-colonel du génie, un gage de ma reconnaissance pour tous les bons soins qui m'étaient prodigués dans son aimable famille, je composai cette barcarole. Faible hommage assurément ! Mais je suis loin de croire ma dette payée.
LE FRANC PECHEUR.
Barcarole calaisienne,
Qu'un autre se plaise à terre, Au sein d'un repos prudent, Moi, pêcheur, j'ai, pour carrière. Choisi l'humide élément. llJ'aime d'un pied téméraire Fouler ce terrain mouvant, Et, dans ma barque légère, Braver les fureurs du vent.
Entendez la laine Qui fait frémir l'âme lDe son bruit aigu; Voyez sous ma rame Fuir le flot vaincu!
Qu'un pâtre pusillanime Presse un gazon paresseux ; Moi, je veux pendre à la cime Du flot qui s'élance aux cieux ; J'aime à descendre en l'abîme Pour remonter radieux, Et lui ravir sa victime Par l'effort d'un bras nerveux.
Entendez la lame, etc
Pour l'habitant du rivage, Le bonheur, c'est un ciel pur ; Pour moi, c'est un long nuage Chargé d'un lugubre azur. C'est l'éclair, d'heureux présage , Déchirant ce voile obscur! Fi du bord où, sans naufrage, L'homme vit tranquille et sur !
Entendez la lame, etc.
Aucuns vantent l'Italie, L'Espagne au ciel toujours beau ; Moi, je n'ai qu'une pairiel, C'est la mer, c'est mon bateau, Où je brave la furie Du vent, du ciel et de l'eau. l On ne goûte bien la vie Que sur le seuil du tombeau.
Si, malgré ma rame, Quelque jour la lame M'emporte vaincu , Qu'importe à mon âme? Elle aura vécu.
14 novembre.
BANQUET AUX CALAISIENS DANS LES TUILERIES.
Cette visite des Parisiens à Calais el à Londres devait leur être rendue et nous eûmes à recevoir à noire tour, mais à quelques mois d'intervalle, une double députatiosn de Calaisiens et d'Anglais. Aux uns et aux autres nous offrîmes un banquet. Celui des Calaisiens eut lieu aux Tuileries dans le salon de Diane, mis galamment à notre disposition par l'administrateur, avec l'agrément de M. le général Changarnier et du ministre de l'intérieur. Au nombre des convives étaient une dizaine d'officiers du 73" et quelques habitants de Blois ; de sorte que la 11e légion se trouvait tout à fait en famille. Au milieu de l'épanchement général, je dus prendre la parole à mon tour. Voici mon toast :
Ne buvez jamais sans cause, Mes amis! j'ai constaté Qu'il faut boire à quelque chose Pour boire avec volupté.
Partant, ici je propose Que, tout frein mis de côté, Chacun, quadruplant la dose, Boive à la Fraternité.
Mais, pour que la soif s'aiguise Et réponde à notre objet, Permettez que je vous dise Quelques mots sur le sujet.
Pour guider dans sa carrière Notre pauvre humanité, Le Passé sur sa bannière Avait écrit : Charité.
- 2
Aimez-vous les uns les autres, Aidez-vous , vivez en paix. l C'était le cri des apôtres. Il fut traduit en bienfaits.
Mais notre âge en l'Évangile A su trouver mieux encore : lIl nous dit, changeant de style : Fraternisez! Un mot d'or.
La langue n'a pas de terme Plus expressif, plus divin ; Bien compris, ce mot renferme En lui tout le code humain .On
On dit tout quand on dit FRÈRE : Mon frère, c'est mon égal. Comment pourrais-je lui faire Ou lui vouloir quelque mal ?
Pour l'aimer comme moi-même, Je n'ai plus besoin de loi. lNaturellement je l'aime ; Etant mon frère, il est moi.
Croyez-moi, ce mot nous ouvre Un horizon tout nouveau , Où l'humanité découvre L'aube d'un destin plus beau.
Les yeux sur la perspective, Moi, j'avance ; en mon chemin , Si quelqu'un me dit : Qui vive? Je dis : Frère! et prends sa main.
Arriére la politique, Homicide obscurité! Pour moi le mot République N'a qu'un sens : Fraternité.
Saluons la loi nouvelle, Mes frères, le verre en main ! Que l'amitié fraternelle Se scelle ici parle vin!
Par le vin... Ah ! je tressaille : J'oubliais, pacte sacré, Que, sur un champ de bataille Par le sang tu fus scellé !
Oh ! descends sur ma pairie , Divine Fraternité! Et fais que tout sang s'oublie Par notre félicité Bannis les voeux téméraires ! Fais qu'une sainte Unité, Dès ce soir nous rende frères Par l'accord , par la gaîté.
Il faut bien croire, messieurs, que ma poésie, si faible qu'en soit le mérite au point de vue littéraire, répondait au sentiment général, puisqu'à Paris comme & Calais, l'impression en fut votée par acclamation sur la proposition du maire, présidenl-né de la fête. S'il fallait, au surplus, invoquer d'autres témoignages, j'en appellerais à celui de M. le général Changarnier, qui a daigné me faire exprimer sa satisfaction. Voici la lettre que m'a écrite en son nom un de ses aides de camp :
Monsieur,
Le général Changarnier me charge d'avoir l'honneur de vous remercier de l'envoi que vous avez bien voulu lui faire des vers prononcés par vous au banquet du 14 novembre. Ils expriment vos sentiments patriotiques avec un talent dont il se plaît à vous féliciter. Recevez, etc.
L'aide de camp du général, J. de CARiEY.
C'est là , messieurs, un précieux suffrage et qui ne saurait être suspect. J'ai aussi un compliment analogue de M. le général Perrot.
Franchissons quelques dates auxquelles nous reviendrons, et passons à nos hôtes d'outre-Manche. Voici comment le Siècle, qui avait envoyé un de ses rédacteurs à la salle Valentino, rend compte de ce banquet-:
12 avril 1849.
BANQUET AUX ANGLAIS.
Le banquet offert à la députation anglaise par un grand nombre de gardes nationaux des légions parisiennes, a eu lieu hier jeudi dans la salle Valentino. L'ordre et la plus franche cordialité avaient fait de cette réunion , présidée par M. Francisque Bouvet, représentant du peuple, une véritable fêle de famille. De nombreuses santés proposées à la fin du repas, qui sont venues imprimer à cette manifestation son véritable caractère. Ces toasts ont été portés successivement par M. Bouvet: « A l'union des peuples ! »
Par le commandant Ségalas, de la 6e légion : « A nos voisins les Anglais ! »
Par M. Lloyd, président de la députation anglaise: « A l'alliance perpétuelle des peuples anglais et français !
Par le capitaine Froment, de la 7' légion : « A la fraternité ! »
D'autres toasts : « A l'extinction de la guerre ! A la paix universelle ! A la reine d'Angleterre! » portés par des gardes nationaux , ont été suivis d'autres proposés par les Anglais : « A la République française! Au bonheur de la France! etc. »
Enfin une pièce de vers, adressée à nos hôtes d'oulre-Manche par le commandant Theil, de
— 23 -
la 1 légion, et admirablement dite par l'auteur, a excité les plus vifs applaudissements et les plus chauds hurrah de l'auditoire.
Mais ce que nous ne saurions rendre , c'est l'effusion avec laquelle lous les voeux ont été exprimés, ce sont les énergiques élans du coeur traduits dans des langues différentes , mais avec des sentiments qui étaient les mêmes; ces visages amis qui se souriaient sans se connaître; ces mains qui se cherchaient pour se presser avec émotion. Il faut être là soi-même pour apprécier tout le charme de ces fêtes vraiment fraternelles et s'en souvenir longtemps.
On est heureux de pouvoir opposer à toutes les mauvaises passions qui s'étalent si complaisamment aujourd'hui ces manifestations éclatantes des plus nobles sentiments, qui mettent en lumière les bons et vrais instincts du coeur de l'homme.
A neuf heures, les commissaires du banquet, MM. Ségalas, Froment, Horeau et Lance, ont invité leurs camarades à accompagner leurs hôtes jusqu'à leur hôtel, et dans le trajet on a lail une halte au café Tortoni, où la soirée s'est terminée au milieu des fleurs, du punch , des glaces, et surtout des assurances réciproques de la plus franche cordialité.
Je n'ai qu'une observation à faire sur ce compte rendu : il ne dit pas qu'à un toast porté au président de la République par M. Kennart, je répondis le premier par un toast à la reine Victoria, voulant montrer par là que la fraternité des peuples est indépendante de la forme des gouvernements.
Voici maintenant les vers dont parle le Siècle. Je les extrais de la Patrie qui voulut bien les insérer le soir même du banquet, afin que les convives anglais qui repartaient le lendemain les pussent emporter.
Quand la lyre frémit et demande au poëte
Ses plus nobles accents, La corde ne saurait longtemps rester muette, Ni le coeur contenir ses fougueux mouvements.
Récents amis, que ce banquet rassemble ; Hôtes qui, réunis en frères sur ces bords, Etonnés, mais heureux de vous trouver ensemble, Livrez votre âme à de communs transports ; Dites-moi, quel pouvoir a produit la merveille De votre intimité?
De l'antique hospitalité Est-ce l'esprit qui se réveille Et veut que dans vos coeurs profondément sommeille L'héréditaire hostilité ?
Une voix, douce à votre oreille, A-t-elle, murmurant quelque mot enchanté, Dissipé tout à coup vos pensées de la veille,
Eteint votre rivalité?
Ou bien votre amitié n'est-elle que la trêve Qui suspend les hostiles voeux, Jusqu'au moment où Mars se lève Pour rouvrir ses terribles jeux?
Cet éclair de bonheur qui brille dans vos yeux N'est-il que le rayon pluvieux qui soulève
Un instant le voile des cieux
Avant que le nuage crève,
Afin de jeter à la grève,
Comme un adieu, ses dernier feux ?
Souffrez que ma voix vous éclaire. Le poëte souvent dans les conseils divins Sait lire et clairement révéler à la terre Le secret des destins.
Je ne sais si le monde, en sa course éternelle
Gravitant vers de plus hauts cieux, Epanouit aux feux d'une clarté nouvelle Son front plus radieux ;
Si l'essor qui ravit la terrestre atmosphère,
Sillonnant un éther plus pur, A , dans quelque Océan de subtile lumière Abreuvé son azur;
— 24 -
Ou si du Dieu vengeur le courroux séculaire
Enfin va s'apaiser; Si le ciel, se penchant, va donner à la terre Un fratemel baiser;
Mais la terre a frémi d'une sainte espérance : Je la vois, attendant l'enfantement nouveau . Dans des langes d'amour préparer en silence Un fortuné berceau.
Oui, j'en atteste ici tous vos coeurs qui palpitent, L'humanité va naître à des destins plus beaux , Et ce n'est pas en vain que dans nos seins s'agitenl Des transports si nouveaux.
Ah ! sans doute j'entends la tempête qui gronde , Le cliquetis du fer, les éclats de l'airain ; Je vois les pleurs, le sang ruisseler, et le monde Souillé d'un holocauste humain.
Mais, tout en gémissant, mon âme se rassure. Si j'en crois de mon coeur le fatidique augure, Ces maux sont les derniers que la guerre aura faits.
Bientôt viendra la douce paix, Du monde mutilé refermer la blessure, Des martyrs sous ses fleurs voiler la sépulture , Faire oublier peut-être, à force de bienfaits, Ces outrages sanglants que reçoit la nature.
Quel garant vous faut-il ? N'avez-vous pas ouï, A travers le fracas du belliqueux tonnerre,
Cet unanime cri Jeté dans la bataille aux échos de la terre , Et par eux aussitôt saintement recueilli : FRÈRES, PLUS DE COMBATS! MAUDITE SOIT LA GUERRE!
Ce cri, rien ne le peut étouffer désormais.
Toute l'humanité, confuse et repentie,
Le murmure; il s'élève, avec même énergie ,
De la pauvre cabane el du riche palais.
Il n'est plus un mortel dont la voix attendrie
Ne dise, détestant la guerre et ses forfaits,
« Que la terre est de tous la commune patrie,
Qu'il y faut vivre en frère et travailler en paix. «
C'est qu'enfin dans nos coeurs la divine semence
Porte son fruit de charité ; C'est que les temps sont mûrs ; que sous le ciel commence
L'ère de la fraternité. Ouvrons-la : que par nous, chers hôtes, s'inaugure
L'universel embrassement! Faisons de ce banquet une Pâque où s'abjure L'ancien ressentiment!
Combien notre union pour tous serait féconde !
Du globe arbitres souverains,
Nous pouvons, unissant nos mains, D'un invincible sceau sceller la paix du monde.
Aujourd'hui, Dieu de paix, jusqu'à loi montera
Le cri d'amour qui de nos coeurs s'élance!
Le regard de notre espérance,
Tourné vers loi, te touchera !
Tu baieras, par la puissance, Le jour où ton soleil, plus radieux, luira Sur la terre arrachée à l'antique souffrance ,
Où chez tes peuples régnera
— 25 —
La concorde avec l'abondance ; Où, dans leurs coeurs, s'effacera Même du nom la différence. Hâte ce jour, Dieu de clémence, Et de tes fils, quand il viendra, L'unanime reconnaissance Te bénira !
Et vous dont la prière à nos voeux s'associe, Dont l'âme avec notre âme en ce jour communie,
Hôtes sacrés, convives saints! Portez dans vos foyers, par vos mains recueillie
Et vivante en vos seins, L'étincelle d'amour, d'humaine sympathie,
Du contact de nos coeurs jaillie!
Gardez-la bien ! elle sera
Le gage heureux de l'alliance
Qui bientôt, j'en ai l'espérance,
D'un noeud sacré nous unira.
Des mers qu'importe la distance ?
Pour la combler, le coeur est là.
Ayez, Anglais, toujours du beau séjour de France Au coeur la douce souvenance Quand vers nos côtes cinglera Le vaisseau qui ramènera Dans nos cités votre présence, Sur le flot qui le portera Notre oeil tendu longtemps d'avance
Le cherchera. Revenez donc ; toujours en France L'Anglais, gardez-en l'assurance, Chez des frères se trouvera. Napoléon THEIL.
Dirai-je qu'une copie autographe de ces vers m'a été demandée pour être envoyée au lord-maire de Londres; que M. Kennart, un des présidents du banquet, les a fait traduire en anglais, vers pour vers, et a eu la galanterie de m'envoyer un exemplaire manuscrit de cette traduction ?
Reprenons l'ordre chronologique un instant interrompu.
10 décembre.
Bien que je ne doive compte qu'à ma conscience de mon vote dans l'élection du 10 décembre, je tiens à ne pas garder le silence sur ce point. Je n'ai pas voté pour L. Bonaparte ; j'ai même fait ce que j'ai pu pour diminuer les chances de son élection ; et plus d'un m'a vu soutenir, à mes risques et périls , dans des groupes fort exaltés , la candidature du général Cavaignac. Et cependant, que devais-je au général Cavaignac? qu'avait-il fait pour moi, dont il n'ignorait point les services? Rien. Mais je croyais, en âme et conscience, la présidence du général meilleure pour le pays que celle de L. Bonaparte, et j'ai voté selon ma conscience. Après l'élection j'ai cru devoir, sans rien dissimuler de ce que j'avais fait, aller, comme tout le monde , et par respect pour le principe, rendre hommage à l'élu de la nation.
24 décembre.
Louis Bonaparte venait d'être nommé, par six millions de voix, président de la République; et il allait inaugurer, par une grande revue de la garde nationale et de l'armée, la prise de possession du pouvoir exécutif. Cette solennité devait être belle; car tout le monde était unanime, et les dissidents de la veille , s'inclinant avec respect devant le suffrage universel, s'apprêtaient à saluer cordialement, sans arrière-pensée, l'élu de la France. Cette heureuse unanimité faillit être troublée par un excès de prudence. La veille de la revue, il fut officiellement recommandé à la garde nationale (j'ignore la consigne de l'armée) de s'abstenir, le lendemain, de toute espèce de cri.
Il ne fallait crier, disait-on, ni vive la République, ni vive le président. Je comprends les
— 26 -
craintes de l'autorité. Un cri en provoque un autre, et à des cris très-légitimes pouvait répondre un cri inconstitutionnel, par exemple, vive l'empereur ! Cela sans doute eût été fâcheux , et je m'associe à l'honorable scrupule, au noble sentiment de pudeur nationale qui a dicté cet ordre du jour ; mais n'était-il pas à craindre aussi que, dans le cas d'un absolu mutisme, quelqu'un de ces hommes qui ont la manie de tout interpréter (et ces hommes ne sont pas rares autour des princes ) ne vînt dire au président : Prince, vous voyez bien que le peuple, en France, ne veut pas de la République. On n'a pas entendu à la revue un seul cri exprimant sa sympathie pour cette forme de gouvernement. Le prince , qui a du jugement et qui est observateur, n'eût pas manqué d'objecter qu'on n'avait pas non plus crié vive le président. Mais les gens dont je parle ont réponse à tout ; ils eussent répliqué : C'est tout simple; qui ne veut pas de République ne veut pas de président. Que serait-il advenu, si le prince, qui est logicien, eût tiré à part lui la conclusion : donc on veut un empereur ? C'eût été bien pire que si quelques amateurs isolés, perdus au milieu d'une foule immense, eussent, à leurs risques et périls, crié : vive l'empereur ! Évidemment, l'auteur de la consigne n'avait pas bien réfléchi. Pour éviter Charybde, il tombait dans Scylla. Et puis, qu'est-ce qu'une fête où on ne crie pas? Le peuple en général, et celui de Paris en particulier, n'est point accoutumé à rester muet les jours de grande solennité. Quand il se tait, c'est qu'il a une leçon à donner; il y a longtemps qu'on l'a dit : « Le silence du peuple est la leçon des rois, » et sans doute aussi des présidents de République. Pourquoi donner une leçon à qui ne la mérite pas? — Toutes ces considérations, messieurs, me frappèrent à la fois. Aussi, je vous le confesse, je m'insurgeai ouvertement contre cette malencontreuse consigne. Tout le corps des capitaines en fit autant, et le lendemain toute la légion, ou du moins tout mon bataillon, s'appliqua à réjouir, par les cris mille fois répétés de vive la République ! vive le président! l'oreille encore novice de l'élu du 10 décembre. L'enthousiasme fut si chaud, si communicatif, que l'escorte du président ne put s'en défendre, et que, quand le cortège passa devant notre front, dans le jardin des Tuileries , tout le monde faisant chorus, lanciers, cuirassiers, état-major, il fallut au président et à M. le général Changarnier tout le sentiment de leur dignité pour ne point mêler leur voix à ce concert. Encore n'affirmerais-je point que l'entraînement de l'exemple et la puissance des sympathies n'aient triomphé en ce moment de la consigne et du respect humain. A la bonne heure! C'est ainsi qu'il fallait saluer l'élu de la France , l'héritier d'un nom qui nous sera deux fois cher ; car il se liait déjà étroitement au souvenir de la gloire nationale, et il se liera désormais d'une façon non moins intime au berceau de la liberté.

Élu président de la République,Louis Napoleon Bonaparte prète serment à la Constitution devant l'Assemblée constituante le 20 décembre 1848.
29 janvier.
Voilà encore une de ces dates dont le souvenir doit être pénible à la garde nationale; car elle rappelle toutes les perplexités qui naissent d'une situation fausse et d'une douloureuse incertitude. D'une part, le bruit circulait qu'une formidable insurrection populaire allait éclater, et l'imagination de plusieurs était troublée par le spectre pour ainsi dire évoqué des journées de juin; de l'autre, une sourde rumeur attribuait au pouvoir l'intention de faire un coup d'État contre l'Assemblée nationale. Les uns voyaient le danger en bas, les autres l'attendaient d'en haut; chacun, sans doute, avait ses raisons. Moi, tout aussi étranger aux mystères politiques des hautes régions qu'aux trames secrètes des conspirateurs de club, je n'avais qu'une opinion, et je la disais tout haut : c'est que, de quelque part que vînt le péril, il n'y aurait jamais qu'un intérêt menacé, la loi, c'està-dire l'ordre, que la garde nationale a été instituée pour défendre envers et contre tous. Ce fut aussi, je crois, l'avis de mon bataillon.
Quelques documents qui ont leur valeur.
Je pourrais, messieurs, revenant aux documents imprimés ou manuscrits, multiplier à l'infini les preuves de l'esprit qui m'anime ; je pourrais vous transcrire ici dos toasts à la paix, à l'union, à la famille, prononcés, au milieu des marques de la plus vive sympathie, dans divers banquets où l'on m'avait fait l'honneur de m'inviter, notamment dans ceux que la 8e compagnie de mon bataillon renouvelle de temps en temps pour cimenter la touchante union de ses membres; je pourrais mettre sous vos yeux des discours prononcés sur des tombes et empreints de cet esprit mélancolique et religieux que ce qui se passe autour de nous inspire plus ou moins à tout le monde, et qui n'est jamais plus vif
— 27 —
que sur le bord d'une fosse ouverte; mais je ne veux point augmenter le bagage, déjà considérable, que j'ai été forcé d'étaler sous vos yeux. Grâce toutefois pour quelques mots prononcés le 5 juin 1849, au cimetière du Mont-Parnasse, sur la tombe d'un de mes lieutenants, et qui empruntent à cette date une certaine valeur.
Chers camarades ,
Voici encore une tombe qui s'ouvre pour se refermer sur un de nos frères. La mort, depuis quelque temps, fait de cruels ravages dans nos rangs, et la soudaineté de ses coups les rend plus douloureux encore. Il est triste de voir ainsi moissonnés ceux qu'on a vus la veille pleins de force et de santé, dans toute la vigueur de l'âge et qui semblaient avoir devant eux une longue carrière à parcourir. Cela est plus triste encore, quand les victimes frappées étaient de bons et braves citoyens, pleins du sentiment de l'honneur et de l'amour du devoir. Le lieutenant Morel élait de ce nombre : ancien brigadier de hussards, il avait noblement payé sa dette à la patrie; rentré dans la vie civile, il y exerçait honorablement une profession modeste et se voyait entouré de l'estime et de l'affection de tous ceux qui le connaissaient. Dans ces funestes journées où la patrie eut à pleurer sur tant de malheureuses victimes des dissensions civiles, nous l'avons tous vu accomplir avec intrépidité le pénible devoir imposé à la garde nationale. Mais écartons ces cruelles images, ou plutôt que ce souvenir adoucisse l'amertume de nos regrets. Il est des époques dans la vie des peuples où la mort peut être considérée comme une faveur du ciel, comme un présent de la fortune. Après les tristes scènes que nous avons vues, au milieu des difficultés du présent, en face d'un avenir chargé de nuages, ceuxlà sont peut-être moins à plaindre qui s'en vont que ceux qui restent, et je ne sais si ce sont des regrets ou des félicitations que nous devons répandre sur cette tombe. Quoi qu'il en soit, adieu, Morel; adieu, brave et digne camarade. Né sois point inquiet de la veuve, il lui reste une famille; cette compagnie, ces frères d'armes qui te rendent ici les derniers devoirs ne l'oublieront pas. Adieu donc, brave Morel. Repose en paix dans le sein DE DIEU, notre père.
Ces citations, messieurs, doivent suffire à vous démontrer que la propagande que j'ai l'habitude de faire, comme chef de corps, n'est pas bien dangereuse, qu'elle ne ressemble guère à des déclamations d'anarchiste et de boute-feu, et qu'elle indique plutôt, à ce qu'il me semble, un sincère, un ardent ami de la paix et de l'ordre. Mais, tenez, on ne prouve jamais trop, et je veux achever de vous convaincre, au cas qu'il vous reste quelques doutes. Vous m'avez vu jusqu'ici prêchant, en vrai prédicateur, dans les occasions solennelles et devant de grandes assemblées, ce qu'il est toujours bon de prêcher en pareille circonstance, je veux dire l'horreur de la guerre, l'esprit de paix, de charité, de fraternité. Vous allez me voir maintenant, conciliateur discret, intervenir à petit bruit dans les démêlés intérieurs de notre pauvre légion, qui est bien changée depuis février, et par une initiative déclarée généreuse par des adversaires, ramener dans nos rangs troublés sinon la concorde et la sympathie d'autrefois, du moins le calme et la paix. La lettre suivante, insérée dans la Patrie du 10 mars 1849,, vous initiera aux détails et de la querelle et de la pacification.
AFFAIRE FORESTIER.
Nous recevons de l'honorable commandant Theil la lettre suivante. Nous nous empressons d'autant plus de l'accueillir, qu'elle nous paraît devoir terminer honorablement le débat qui s'était élevé dans la IIe légion.
Monsieur le rédacteur,
Je regrette d'avoir à intervenir dans une polémique engagée entre des collègues et des frères d'armes; mais on invoque mon témoignage, on en appelle à ma loyauté; j'obéis. Puisse la vérité, que je vais exposer tout entière, dissiper d'injustes préventions, et clore enfin un débat qui n'a pas de motif sérieux.
Voici les faits : Un comité s'était formé dans la 6e légion, dans le but d'offrir une épée d'honneur au colonel Forestier. M.Pascal, notre lieutenant-colonel, voulut provoquer, dans la il* légion, la formation d'un comité semblable. A cet effet, il invita les officiers supérieurs, ainsi que plusieurs autres officiers et gardes nationaux, à se réunir à l'étal-major. M. Pascal, je dois le déclarer ici, n'eut pas un seul instant la pensée de donner à celte réunion un caractère officiel. Lui-même , à l'ouverture de la séance, eut soin de nous en prévenir.
Malheureusement, le lieu du rendez-vous et la forme de la convocation pouvaient donner le change. Une erreur de rédaction dans un article de journal vint corroborer ces premières apparences. Une mise pour un d, dans l'annonce de la souscription, présentait la il» légion comme unanime. De là, protestation de la part d'un grand nombre d'officiers et gardes
— 28 —
nationaux qui n'acceptaient pas cette solidarité. Tout cela, comme on voit, était parfaitement légitime; souscripteurs et protestants, au fond , étaient dans leur droit. Or, le droit, personne dans la il" légion ne songe, soit à le contester, soit à en entraver l'exercice. Mais la prévention montré tout sous un faux jour.
De part et d'autre, on s'attribua des arrière-pensées; on s'accusa mutuellement de mauvaise foi. L'animation bientôt devint telle qu'il y eut à craindre pour la paix de la légion. Comme, à mes yeux, l'union est le premier besoin, l'intérêt le plus grave du temps où nous vivons, je crus devoir, en présence de la fermentation croissante, faire un appel à la concorde. Voici les conclusions de cet appel :
«Oui, chers collègues, pacifions, n'irritons pas. Plaçons, autant qu'il est en nous, la République de février sous ses véritables auspices; édifions-la sous l'invocation de la concorde; faisons en sorte, en un mot, que la fraternité ne soit pas seulement un nom inscrit au frontispice de nos monuments, mais une réalité vivante dans nos coeurs.
» Je propose donc que chacun de nous, conservant dans le sanctuaire intime de sa conscience ses opinions et ses sympathies personnelles, en sacrifie l'expression publique à l'intérêt supérieur de la bonne entente et de la paix ; je propose de plus que le montant des souscriptions recueillies ou à recueillir soit consacré, avec l'assentiment des souscripteurs, à un acte de bienfaisance. Tout le monde ainsi sera content : les pauvres que nous aurons soulagés, la légion revenue à son calme et à ses sentiments habituels, enfin, et plus que personne, les destinataires des épées d'honneur qui, devenus l'occasion d'une bonne oeuvre, non d'une scission fâcheuse, croiront, n'en doutez pas avoir plus gagné que perdu. »
Muni de cette pièce , je me présentai chez mes collègues ; j'exposai à chacun d'eux la gravité de la situation et la nécessité d'arrêter le mal. J'eus le bonheur de voir les plus résolus , les plus irrités, se rendre à mes raisons, et, après plus ou moins d'objections, signer ce traité de paix.
Un honorable scrupule, dont l'honneur appartient à nos deux colonels, a tout perdu. Avant de porter à la Patrie la nouvelle de cette heureuse pacification, on jugea convenable de voir le colonel Forestier, et d'obtenir son assentiment. M. Pascal et moi nous nous rendîmes auprès de lui. Voici ce qu'il nous répondit :
« Messieurs, je déplore 1 comme vous la scission qui a éclaté dans votre légion , et je m'associe de grand coeur, comme homme, comme citoyen, à la pensée de conciliation qui vous anime; mais vous me demandez de ratifier comme colonel l'acte de votre pacification : je ne me reconnais pas ce droit; comme colonel, je ne m'appartiens pas; mon injure est l'injure de la garde nationale. Ce n'est pas à moi, Forestier, que s'adresse l'hommage ou plutôt la réparation dont il s'agit: c'est à l'épaulette que je porte. Je n'ai pas qualité pour vous délier de ce que vous-mêmes vous avez considéré comme votre devoir. Je ne suis, moi, ajouta-t-il , que le soldat infime d'un principe , d'un parti ; et, en matière si grave, je ne puis prendre aucune résolution sans avoir préalablement consulté mes amis. Je vous demande un jour de réflexion. » — Ce langage était noble ; nous dûmes déférer au voeu qui nous était exprimé d'attendre. M. le colonel Forestier consulta donc ses amis, et la conférence eut pour résultat la lettre signée Forestier, qu'on a lue, le 28 février, dans le National, lettre qui a mis, je dois l'avouer, les négociateurs de la 11e légion et le colonel Forestier lui-même dans une situation fausse, en déplaçant l'initiative, en ne tenant aucun compte d'un fait accompli, d'une transaction signée.
MM. Pascal, Monduitel Rousseau m'avaient, il est vrai, dès la veille , et dans l'incertitude du dénouement à intervenir, redemandé leur signature ; mais nos adversaires , étrangers à ces négociations, et qui devaient les ignorer, avaient certainement le droit, dont ils ont usé, d'arguer contre nous d'un traité dont ils ne pouvaient supposer la rupture, et sur la foi duquel ils avaient suspendu toute polémique.
Quant à moi, placé par cet incident inattendu dans une situation très-délicate, lié aux signataires de la souscription , par la communauté des sympathies ; aux adversaires de la manifestation , parle traité conclu, et dont je puis , moins que personne, me considérer comme dégagé ; aux uns et aux autres par un sentiment sincère d'estime et d'affectueuse confraternité ; fidèle, d'ailleurs, à la pensée de paix et d'union qui sera toujours ma plus chère pensée, j'ai dû, en de telles circonstances, m'abstenir de toute démarche contraire à la stricte neutralité.
Obligé d'intervenir aujourd'hui pour rendre hommage à la vérité, je l'ai fait, et mes conclusions sont celles-ci : La scission qui a éclaté dans la i 1e légion n'a pas de cause sérieuse. La querelle ne repose que sur des apparences interprétées par la prévention. Quand les prétendus adversaires voudront s'entendre , il leur suffira, j'en suis sûr, de donner un instant audience à leurs sentiments intimes, et à se pénétrer de cette vérité que j'ai plus d'une fois expérimentée et qui ressort d'ailleurs de toute cette affaire : le coeur inspire mieux que la politique.
Veuillez agréer, etc.
Vous le voyez, messieurs, je ne prêche pas seulement, je. pratique. C'est plus rare. Je n'ai plus, messieurs, qu'un document à produire ; mais il doit être décisif et em porter de vive force les convictions les plus rebelles. C'est la profession de foi que j'avais
— 29 —
préparée comme candidat aux dernières élections dans le département de la Haute Vienne. Cette pièce n'a pas été composée pour le besoin de ma cause ; je l'ai lue à Paris et à Limoges même à diverses personnes qui la reconnaîtront. Elle a d'ailleurs été saisie avec d'autres papiers non moins innocents, dans la perquisition faite à mon domicile, il y a deux mois.
Aux électeurs de la Haute-Vienne.
Chers compatriotes,
Aux époques de crise politique ou sociale, c'est la tentation et peut-être la mission des hommes qui se sentent quelque force dans l'intelligence, quelque vigueur dans l'âme, de chercher la lutte et de se mettre au service d'une cause.
Enfant de Limoges, connu de beaucoup d'entre vous, je viens, prêt à descendre dans la lice politique, solliciter de vous un mandat qui me l'ouvre.
La cause que j'y veux servir est la même que j'ai constamment servie par mes écrits et par mes actes, celle du progrès par l'ordre, ou plutôt de l'ordre par le progrès; j'entends par ces mots la marche incessante et pacifique de l'humanité dans la voie providentielle qui mène à la Liberté, à l'Égalité, à la Fraternité, c'est-à-dire à une société vraiment humaine.
Cette voie est longue ; il faudra plus d'un jour pour la parcourir ; elle est, de plus , semée d'écueils-, et il y faut marcher avec prudence. Y courir, c'est tenter l'abîme.
La France, en donnant à son gouvernement la forme républicaine, a dégagé de beaucoup d'entraves sa marche vers ce but; mais tous les obstacles n'ont pas disparu ; il en reste encore , il en reste qui sont inhérents à l'état actuel des esprits et aux conditions présentes de la société.
Devant ces difficultés qui sont sérieuses, la tâche de l'Assemblée législative sera délicate. Elle aura à ménager les intérêts du présent en servant ceux de l'avenir. Une série de mesures sagement calculées pourra seule satisfaire à cette double nécessité et faire équitablement la part du droit ancien et du droit nouveau. Quelles seront ces mesures? Je n'ai pas la prétention de le savoir. Sans être étranger aux graves questions qui s'agitent, j'avoue humblement n'avoir point de système tout fait. Peut-être est-ce un avantage. Je ne viens donc pas vous dire: j'ai trouvé; je vous dis simplement: il faut chercher; je chercherai, je chercherai avec une ardeur patiente et consciencieuse.
Mais si je n'ai point d'idées arrêtées sur le détail des mesures à prendre , en revanche je suis invariablement fixé sur le but et sur les moyens généraux. Réaliser graduellement, pacifiquement, la triple devise de février, voilà le but; éclairer, moraliser les masses ; augmenter, autant que possible, la somme de leur bien-être matériel ; réformer profondément le système actuel d'enseignement et d'éducation ; rétablir enfin le plus tôt possible le calme dans les esprits, dans les coeurs et surtout dans la rue .-voilà les conditions fondamentales. Tout lereste découle de là ; c'est une affaire de bonne foi, de bon sens, de bonne volonté. — Pour obtenir ces résultats, je mettrai toute mon intelligence, toute mon activité, toute mon âme au service du pays. Quand je dis le pays, j'entends tout le monde, les grands comme les petits, les riches comme les pauvres, tous les intérêts étant nécessairement liés et solidaires. Je ne fais point de catégorie dans la famille française. Tous mes concitoyens me sont également chers; je tiens compte de tous les droits acquis, de tous les intérêts légitimes, je respecte toutes les opinions sincères, et en général je crois plus à la prévention, à l'erreur, qu'à la méchanceté et au mauvais vouloir. Scinder, comme on le fait, la nation en rouges, bleus et blancs, et fonder sur ces classifications fort arbitraires une gradation dans la fraternité, c'est, selon moi, déchirer le drapeau de la France, où les trois couleurs sont unies et françaises au même titre
Je me présente donc à vous, le drapeau tricolore à la main. Soldat fidèle et résolu, je le défendrai avec toute l'énergie de mon caractère, laissant au temps, ce grand conciliateur, le soin de fondre les nuances et de décider le ton général. Si vous pensez qu'un autre puisse le porter plus fermement que moi, que celui-là soit votre élu ; je m'en réjouirai, surtout s'il est enfant du pays. Dans le cas contraire, disposez de moi.
Napoléon THEIL, ancien chef d'institution à Limoges, etc.

Voilà, messieurs, dans quelles dispositions d'esprit et de coeur m'a trouvé la journée du 13 juin 1849. Ma conduite, ce jour-là , a été de tout point conforme à mes antecé-
- 30 -
dents. Au premier appel j'ai pris le commandement de mon bataillon. Tous ceux de nos camarades qui ont stationné avec moi depuis midi jusqu'à dix heures du soir sur la place de la Sorbonne, savent quels ont été mes discours et mes actes. Je les livre à leur appréciation. Quant aux accusations portées contre moi et dont l'enquête judiciaire a fait justice, vous approuverez la réserve qui me les fait passer sous silence. Je serais obligé de remonter aux sources et de citer des noms qu'il faut taire, des noms que je ne veux pas savoir.
Il n'est resté de tout cet échafaudage d'inculpations que les faits indiqués dans l'arrêt de suspension prononcé contre moi par le conseil de préfecture. Ces faits sont ils des griefs sérieux? c'est à vous d'en juger. Quant à moi, j'en assume de grand coeur la responsabilité.
Voici les considérants de l'arrêt du conseil de préfecture :
Considérant qu'appelé à présenter devant nous, siégeant en conseil de préfecture, ses observations sur les faits qui lui étaient imputés, M. Theil a donné en quelques mots des observations satisfaisantes ; que dans le mémoire développé dont il a donné lecture, il a protesté de son dévouement à la cause de l'ordre;
Considérant toutefois qu'il est avéré que le matin du 13 juin, dans la cour de la mairie, où se trouvaient alors les gardes nationaux du poste et un détachement de troupes de ligne, il a énoncé à haute voix, à la suite d'altercations avec d'autres citoyens, que la Constitution avait été violée par l'Assemblée législative;
Considérant qu'il est également avéré que le 13 au soir, sur la place Sorbonne, après quelques paroles échangées avec le général Sauboul, il a poussé à la tête de son bataillon, le cri de vive la constitution qui, très-légitime en lui-même, était alors le cri de ralliement de la manifestation organisée contre le gouvernement et contre l'assemblée ;
Considérant qu'en agissant ainsi, M. Theil a méconnu les devoirs d'officier de la garde nationale et de chef de corps, et que sa conduite a été de nature à troubler l'ordre et à ébranler la discipline parmi les gardes nationaux confiés à son commandement ;
Considérant que , d'après ces motifs , il y a lieu de faire application à M. Theil des dispositions de l'art. 61 de la loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale,
Avons arrêté ce qui suit:
M. Theil est suspendu pour deux mois des fonctions de chef de bataillon de la 11e légion de la garde nationale de Paris.
Fait en conseil, le 25 août 1849.
Pour le représentant du peuple préfet de la Seine en congé,
Le conseiller de préfecture délégué,
Signé, PONTONNIER. Pour amplialion ,
Le secrétaire général, CH. MERRUAU.
Je ne ferai sur ces considérants qu'un très-court commentaire: quand, le matin , dans la cour de la mairie, j'ai exprimé l'opinion que la constitution avait été violée, il était huit heures; la garde nationale n'était pas encore convoquée; je parlais, simple citoyen, à de simples citoyens qui m'avaient interpellé et demandé mon avis;—quand, le soir, sur la place Sorbonne, après dix minutes de promenade et de conversation affectueuse avec le général Sauboul, j'ai crié : Vive la Constitution ! je n'étais pas à la tête de mon bataillon ; mon bataillon, conformément aux instructions reçues , était disséminé sur six ou sept points différents , et il n'y avait sur la place Sorbonne qu'une vingtaine de gardes nationaux gardés à vue par tout un bataillon du 61e de ligne ; — quand j'ai crié, je l'ai fait pour régler, par une prudente initiative, une manifestation qui ne pouvait être empêchée et pouvait, abandonnée à elle-même, prendre un caractère plus grave; je l'ai fait en en demandant la permission au général et en lui serrant la main. Trois jours après, je l'ai revu et il m'en a remercié. — Ces observations que je vous soumets, messieurs, je les ai faites au conseil de préfecture. Ce ne sont pas celles apparemment qu'il a trouvées satisfaisantes, puisqu'il m'a condamné nonobstant. Comme pourtant je n'en ai point fait
- 31 —
d'autres , j'ai de la peine à m'expliquer cette satisfaction. J'y crois néanmoins ; et, malgré l'originalité de la preuve , je tiens ces messieurs pour satisfaits. Ils le sont, à coup sûr, plus que moi.
Voici le texte de ma démission :
Monsieur le maire,
Paris, 28 août 1849.
Lorsque , le 16 de ce mois, j'allai à la mairie remettre entre vos mains ma démission de commandant du 2e bataillon, vous m'apprîtes que, selon toute apparence , j'allais être appelé devant le conseil de préfecture pour y donner des explications sur ma conduite. Je crus de mon devoir d'attendre cette nouvelle enquête, et je retirai ma démission. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun motif de l'ajourner, et je cède aux circonstances impérieuses qui m'obligent à consacrer désormais tout mon temps à mes intérêts domestiques, trop longtemps négligés. Recevez donc ma démission, et croyez que, si ma responsabilité diminue avec l'importance de mon rôle, mon dévouement à la chose publique reste entier. L'arrêt qui me frappe n'altère en rien mes sentiments. J'ai d'ailleurs pour adoucir, au besoin, l'amertume de mes réflexions, I a conscience d'avoir été dévoué toujours, utile quelquefois, à la double cause de l'ordre et de la liberté.
Veuillez agréer, monsieur le maire etc.
THEIL.
PARIS. - — IMPRIME PAR E. THUNOT ET RTE Ce RACINE, 26